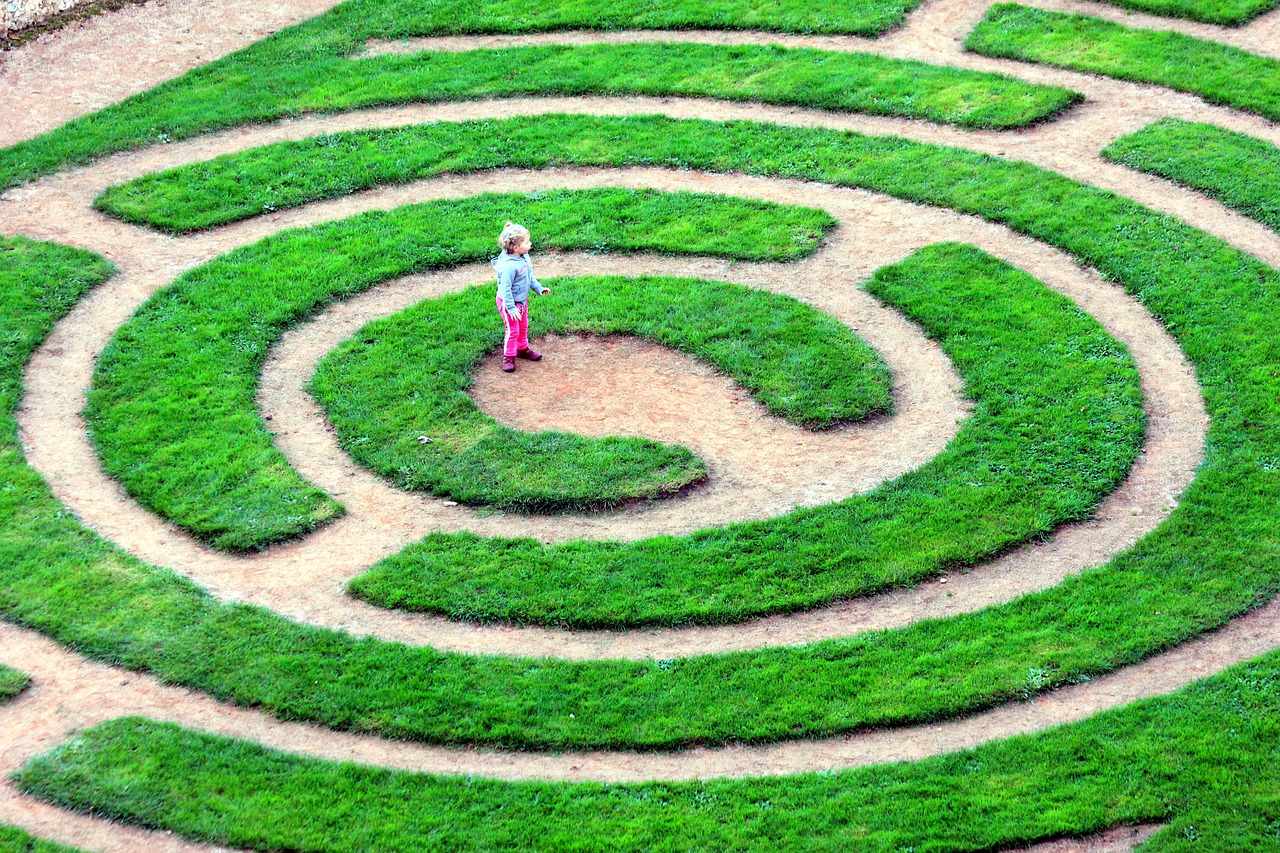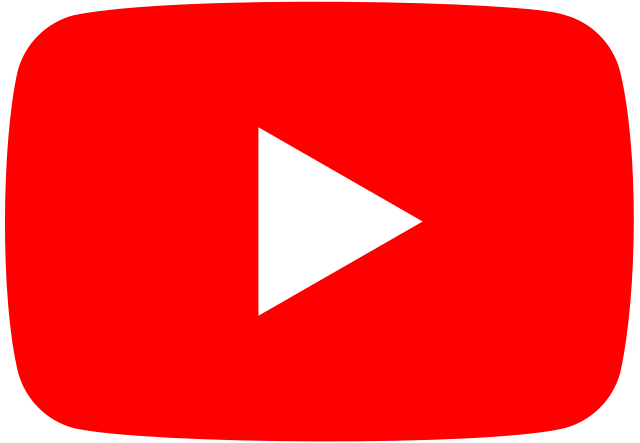Actualités

Finance transformatrice ? Un documentaire à voir et revoir ...
Des image d'archive de Nicole Reille (1930-2012), fondatrice de l'association Éthique et Investissement (1983), ouvrent le film diffusé dimanche 31 août sur France 2 (10h-11h) et en replay bien sûr ! Ce documentaire de Claire Jeanteur intitulé Les Jardiniers de l'Économie "défriche" une question ardue, avec un enjeu majeur: "La Révolution responsable aura-t-elle lieu?"
Résultat, un film à la fois instructif et ludique. Grand public, sans être trop simpliste.
Pourtant, le gant n'était pas évident à relever : intéresser le public dominical à la finance, qui plus est "responsable", agissante, en vue d'une économie plus humaine... Soit, un sujet technique, réputé difficile, accessible aux seuls experts de l'ISR (investissement socialement responsable). Le voilà traduit dans un documentaire cuménique sensible, compréhensible par le plus grand nombre finalement. Défi relevé !
"Cest lhistoire dun combat méconnu aux enjeux planétaires avec ses pionniers, ses conflits, ses coups darrêt et ses reprises. Ce mouvement qui incite les entreprises à grandir dans leur responsabilité, où la finance se fait levier de transformation, nest pas une utopie. Rencontres avec des femmes et des hommes engagés" prévient la réalisatrice, Claire Jeanteur. Contactée au moment où nous cherchions à célébrer, de plusieurs manières, les 40 ans de notre association en 2023, la documentariste a manifesté son intérêt, fait preuve d'une curiosité tenace, à la fois ingénue et ingénieuse. Dès origines à aujourd'hui le propos porté à l'écran est plutôt limpide.
Pour une économie plus humaine, des jardiniers d'un certain type...
Historiquement, en Occident, les investisseurs religieux ont joué un rôle déterminant dans cette finance singulière, avant qu'elle ne prenne un essor laïc, bien plus large -d'où l'implication du Jour du Seigneur et de Présence Protestante en l'occurrence débouchant sur cette production.
La fondatrice d'Éthique et Investissement, Économe d'une congrégation née à Nancy (Notre Dame-Chanoinesses de Saint-Augustin) a encouragé la première agence de notation extrafinancière française (Arèse, Geneviève Férone), participé au FIR (Forum français pour l'Investissement Responsable), ce que le documentaire met, notamment, en lumière. Il se poursuit avec quelques-uns des fruits de cette histoire, dont la Loi française sur le Devoir de Vigilance (Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle), Le Campus de la Transition (Cécile Renouard) et plus largement l'activisme actionnarial porté par une pluralité d'ONG favorables à la transition écologique et sociale; ce sont autant de facettes de "l'économie responsable" que ce film illustre avec justesse. Et elles sont nombreuses, subtiles, un peu comme si.... "plusieurs chemins mènent à Rome". C'est pourquoi des témoignages fort divers ponctuent cette exploration, parmi lesquels ceux de :
Jerôme Courcier Président dEthique et Investissement
Geneviève Férone Fondatrice dArèse
François Faure Agent général dassurance, Prédicateur protestant, Président-Fondateur du RéseauCEP
Nicole Notat Ancienne Secrétaire générale de la CFDT (1992-2002)
Dominique Potier Député de Meurthe-et-Moselle, Président de l'association Esprit Civique
Cécile Renouard Présidente du Campus de la transition
notamment. Ce film croise les regards de catholiques et de protestants engagés, de laïcs, dans un mouvement misant sur des comportements d'actionnaires/épargnants propres à "faire grandir" la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Un élan qui, naturellement, connaît des cycles plus ou moins "porteurs" comme l'actualité récente le rappelle, dont ce documentaire ne fait pas abstraction.
Au fil des saisons, tenir bon
Liés à cette vision de la finance et de la responsabilité effective de tout épargnant/investisseur, sans dogmatisme, les espoirs, les atermoiements également d'une transformation épique sont mis en évidence. Comme le résume la réalisatrice Claire Jeanteur : « Jaime lidée que ce film soit comme un voyage au fil dun mouvement qui, en visant à transformer léconomie, nous transforme également, nous rend plus conscients, plus responsable. Être responsable, cest dabord oser se poser les bonnes questions, savoir aussi renoncer au profit à court terme pour privilégier linvestissement à long terme».
Ce diagnostic et cette ambition sont au cur de notre association depuis plus de 40 ans. Dont acte. Continuons de cultiver ensemble la réflexion, l'engagement, au besoin en nous formant. Une occasion de se ressourcer est fournie, grâce à ce film : bonne rentrée et continuation...
chargée de mission d'E&I

Rôle sociétal de l'entreprise, légiférer encore ou bien, stop ?

Deux fois par an, E&I organise une soirée débat ouverte à tous, sur inscription préalable. Celle du premier semestre 2025, détaillée ici, sest tenue le 28 avril après notre AG, sur la réglementation de l'information "extrafinancière" (ESG) des entreprises, battue en brèche malgré des témoignages positifs de celles-ci Quen retenir, du point de vue de linvestisseur responsable et de léclairage qui lui est dû ?
Lenvironnement, le social et la gouvernance (ESG) sont des balises pour choisir nos placements
La finance responsable fait lobjet dun important «retour de bâton » (backlash). A savoir, un flot de critiques ; il vient remettre en cause son rôle, son efficacité et au premier chef, son cadre règlementaire avec la proposition de la Commission Européenne baptisée « Omnibus ». Objectif : réviser les principales directives en la matière, pourtant en vigueur depuis peu dans l'UE.
Sont ciblées en particulier :
- la directive CSRD, qui encadre le reporting « extrafinancier », autrement dit, le devoir de « redevabilité » des entreprises, à l'origine instillée, en France, par la loi NRE (Nouvelles Régulations Économiques) de 2001, afin de renseigner leurs parties prenantes (dont les investisseurs) sur leur modèle daffaires, exprimer leur compréhension et par conséquent, leurs actions quant aux incidences écologiques, sociales, et globalement sociétales liées à leurs activités voire, leurs courbes de progrès en plus des ratios strictement financiers (ESG) ;
- la directive CS3D, alias « Due Diligence » inspirée de la loi sur le Devoir de Vigilance votée en France dès 2017 après le drame du Rana Plazza pour inciter les entreprises « donneuses » dordre à sassurer que leurs sous-traitants respectent les droits humains et l'environnement.
Stop ou encore ?
Cette conjoncture est préoccupante, car les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont cruciaux pour nos buts -"une économie plus humaine"- et l'avenir de notre planète ( "la Création"). Tant de voix sélèvent à l'encontre de ces directives à peine entrée en vigueur, et ce, avec des arguments-massues, dans un brouhaha propice au « dialogue de sourds ». Alors, trop ou pas assez de régulation en l'occurrence ? Une certaine confusion règne. Ont accepté de venir nous proposer un éclairage dans ces circonstances, et d'en discuter avec nous, trois représentantes de points de vue complémentaires :
- celui du droit, par Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre de l'environnement qui a profondément uvré au Code de l'Environnement, à une époque où même, par exemple, Marceau Long s'étonnait d'une telle initiative dans la mesure où, disait-il, "l'interdiction de polluer est déjà stipulée dans notre Code rural" aussi, pourquoi en rajouter ? ;
- celui de la philosophie appliquée à l'entreprise, services rendus à la clé, par Cécile Ezvan, professeure d'éthique et de RSE à Excellia BS, chercheuse associée au campus de la Transition de Cécile Renouard, à l'origine d'un critère reflétant la qualité relationnelle d'une organisation vis à vis de ses parties prenantes (sa capacité à "tisser du lien social"), notamment utilisé pour la gestion du fonds Equicongrethis ;
- celui des agents économiques ayant à appliquer les règles et les normes en question, par Murielle Cagnat Fisseux, DG de Stella Partners (cabinet axé sur la RSE), ancienne co-présidente d'un comité du Medef sur l'excellence opérationnelle ; témoin de leurs réticences affichées à toute entrave aux affaires autant que de leur quête de performance, elle est personnellement convaincue du caractère potentiellement profitable, stratégique donc, des politiques ESG (environnementale, sociale et de bonne gouvernance) tout en appelant à un effort de lucidité sur les dilemmes que la RSE pose aux entreprises.
Au nom de la compétitivité*, l'urgence de simplifier** implique une "pause législative" disent les détracteurs de la régulation telle qu'elle existe aujourd'hui.
Une pause ? Plutôt un détricotage, redouté au contraire par ses défenseurs. Pire, in fine cette (r)évolution consacrerait la loi du plus fort, que promeut sans fard l'idéologie "trumpiste" font valoir ces derniers.
Sans régulation, la jungle assurée
Pour Corinne Lepage, "Ce que nous devons défendre aujourdhui, ce nest plus seulement de nouveaux engagements, mais la préservation des acquis face aux tentatives de démantèlement des réglementations existantes. Labandon de la directive CS3D ("Devoir de Vigilance" ou de "Due Diligence") , la remise en cause des engagements climatiques, la montée du climatoscepticisme... Tout cela témoigne dune cécité que je peine à comprendre. Les entreprises ont un rôle clé à jouer dans cette transition. Pas seulement pour répondre aux obligations juridiques, mais pour se protéger elles-mêmes et assurer leur viabilité dans un monde en mutation". Bien sûr, "le sujet de lefficacité de la réglementation, sous réserve quelle se maintienne, pour atteindre sa finalité reste entier. Nous savons tous peu ou prou, que les normes peuvent être contournées et instrumentalisées pour ne surtout pas progresser. Il en est aujourdhui du greenwashing comme de certaines démarches qualité et de certification visant lamélioration de la qualité de produits ou de services, de la satisfaction clients ou collaborateurs" qui ont eu du mal elles aussi à conquérir leur lettres de noblesse. "Certains continuent encore de faire semblant en la matière ; nous assistons en ce moment à la publication des premiers rapports CSRD, magnifiques dans leur construction, la multiplicité et la diversité des données communiquées qu'en feront la gouvernance, les investisseurs, la société civile? Le sujet reste entier".
Faire semblant, se conformer au sens de "cocher les bonnes cases", pour s'attirer les meilleures notes ESG et donc les "bonnes grâces" des épargnants regardants, au-delà des seuls critères financiers, quant aux progrès en termes de RSE (responsabilité sociétale des entreprises) liés à leurs placements : le biais est connu ; c'est une réalité révélée par un certain nombre de scandales, depuis Enron (2001) jusqu'à Orpéa (2022). Nonobstant le coût réputé exorbitant, acquitté par les organisations pour payer les audits que requièrent la certification des comptes, les normes, les labels, entre autres vérifications requises, imposées ou que s'imposent les entreprises, les "tromperies sur la marchandise" s'avèrent possibles.
Pour autant, le "laissez faire", autrement dit, renoncer aux règles n'ayant pas empêché les déviances observées, est-ce la solution ? Aucune de nos intervenantes ne le croit. En revanche, accompagner, reconnaître et récompenser les meilleures pratiques des acteurs économiques, jalonnent une piste faisant davantage consensus.
L'entreprise a un rôle politique à jouer, mais pas seule...
Le rôle politique de lentreprise, au sein des sociétés contemporaines et envers les générations futures, invite à repenser la responsabilité sociale de lentreprise en fonction de la manière dont elle agit et coopère pour promouvoir des institutions et des systèmes favorables à un développement humain durable. Tel est le credo de Cécile Ezvan, invitée à la tribune de notre soirée-débat.
Cécile Ezvan, Docteur en Philosophie (Université de Lyon) et diplomée de lESCP, travaille sur lévaluation de la contribution sociale des entreprises et la transformation des modèles économiques au service de lintérêt général (modèles circulaires, à impact, entreprises à mission). Avec, par exemple lindice de capacité relationnelle (RCI), elle illustre par ses travaux un courant de la recherche, à visée pragmatique, d'une lignée d'économistes qui préconisent la construction et lutilisation dindicateurs basés sur lutilité sociale de la croissance. Approches passionnantes, mais aussi utiles puisque certaines dentre elles nentendent rien moins que changer lentreprise pour le bénéfice de la société tout entière. Il s'agit, avec l'indicateur RCI par exemple, "d'évaluer la valeur extra-financière de la contribution des entreprises à la qualité du lien social dans un territoire, aux relations entre lentreprise et ses parties prenantes, et plus largement aux milieux vivants". Un rôle "politique", pas seulement économique donc, mais aussi sociétal, que la loi PACTE reconnaissant "l'entreprise à mission" par exemple, a institué il y a peu en France, via son Code Civil remanié. "Une nouvelle société à mission est créée toutes les 18h" claironne BpIFrance. La philosophie et l'entreprise ne sont pas antinomiques, et cette alliance n'est donc pas si rebutante, pas forcément ennemie de la "compétitivité" ni contre-performante.
D'ailleurs, "80 % des entreprises françaises, dont Accor, Nestlé et Decathlon, se disent satisfaites de leur conformité à la CSRD" selon une consultation "à chaud" présentée "à quelques jours du vote au Parlement européen relatif à la directive "stop the clock" visant à reporter de deux ans la CSRD, dans le cadre du "paquet omnibus" de la Commission européenne" relate la journaliste Sabrina Dourlens, dans une dépêche d'AEF Info, à l'issue d'une conférence organisée le 25 mars au Parlement européen à Bruxelles. Intitulée "simplifier la CSRD opérationnellement", elle réunissait acteurs économiques, investisseurs, experts technologiques, décideurs politiques et représentants de la société civile, "tous ont partagé des retours dexpérience concrets sur la mise en uvre de la CSRD et lexploitation des données ESG pour une transition efficace", rapporte-t-elle. Dont, notamment, cet avertissement disant : attention, sur le terrain, "volontaire équivaut à non prioritaire".
L'application des directives pose question, plus que la régulation elle-même !
Pour Murielle Cagnat-Fisseux ayant co-animé un groupe de travail du Medef sur l'excellence opérationnelle et fondé un cabinet expert dans l'accompagnement des entreprises, il faut bien voir les injonctions contradictoires qui sont leur lot. Quand bien même, nécessairement, leur performance se décline aujourd'hui au pluriel (performance non seulement financière mais aussi relationnelle, opérationnelle, sociétale, environnementale... bref, ESG), l'exercice demandé ne va pas de soi. "Il me semble que le monde de la RSE gagnerait à prendre le temps du débrief de fin de match ou de fin de saison. Une défense pas au niveau, un jeu qui manque de fluidité, un manque ou une confusion de leadership, voilà bien des raisons qui ont pu faire faillir de grandes équipes dans le monde du sport collectif. Nous devons nous aussi apprendre à nous organiser, nous entraîner, nous remettre en question, nous armer, aussi bien, et mieux encore, que ceux qui entendent nous empêcher de gagner la bataille de la viabilité de notre monde, et de la dignité partagée". Elle reste optimiste, tout en désignant une marche de progrès à franchir, encore haute. "Il est à craindre que la RSE comme précédemment les démarches de qualité, dexcellence opérationnelle, dinnovation et bien dautres, soient vécues comme laffaire de quelques spécialistes en charge dassurer un minimum de prérequis sur un mode plutôt régalien, et certainement pas comme une préoccupation qui se traduit dans des actes concrets au quotidien, faisant de lavènement de lentreprise contributive l «affaire de tous »."
Une affaire de quelques "experts" vs implication de l'ensemble des métiers, du management ; et du marché
Autre axe de progrès, elle observe que "le lien direct avec les objectifs business nest pas opéré. Pire encore, le temps consacré aux réflexions ou aux actions en la matière est perçu comme une menace à la productivité. En dautres termes sauver la planète et satisfaire ses parties prenantes cest bien, mais les objectifs business dabord. Il faut dire que cest sur ces objectifs quantitatifs que les managers et leurs équipes sont attendus, évalués, valorisés". Dans ces conditions, c'est une véritable gageure que de "sensibiliser les managers et les orienter vers la création de valeur sociétale et environnementale autant quéconomique". N'y aurait-il pas là un point d'attention désigné aux épargnants que nous sommes, appelés à distinguer et donc encourager les agents économiques à cette aune ?
Leurs visions stratégiques exprimées noir sur blanc, les politiques conduites et les plans d'actions allant dans ce sens, résultats à l'appui : voilà des éléments de base, indispensables au dialogue actionnarial, assortis de preuves, sans parler de la communication due au consom'acteur ! Sans doute les exigences des investisseurs qui se veulent responsables devraient-elles être moins tues, pour être davantage moteur, davantage revendiquées notamment vis à vis de leurs banquiers et gestionnaires de fonds, prescripteurs, comme notre association essaie d'en montrer l'exemple, depuis sa création.
Au regard de son application donc, confiée peut-être trop souvent à une poignée de "spécialistes" plus soucieux de sécurisation juridique que d'une application de l'esprit (avant la lettre) des directives mises en cause, la règlementation souffre naturellement d'amélioration, d'ajustements à l'aune des effets observés plus que des procès d'intention. Leur "bureaucratisme", leur "contre-productivité"**, leur caractère a priori pénalisant face aux compétiteurs mondiaux* ... des chiffons rouges chimériques ? Pierre-Henri Leroy, Administrateur d'E&I invite à pousser la réflexion plus loin : Vers un autre « ordre mondial » ? Lequel ? Que faire pour y participer intelligemment, afin que ce qui sortira du désordre/sabordage actuels soit transformé positivement, orienté en vue dun résultat («un nouvel ordre mondial?») compatible avec nos valeurs dinvestisseur engagé, responsable : quels textes (régulation) et pratiques (outils, métriques et praxis) renouvelés devrions-nous discerner et promouvoir ?
Courage, ne fuyons pas trop vite...
Dans une tribune publiée par l'Agefi datée du 27 mars dernier, Pervenche Bérès (présidente de l'AEFR association Europe-Finances-Régulations) et Nicolas Mottis, professeur à Polytechnique avertissent : "Détricoter les règles sur la finance verte est une fausse bonne idée".
"Il est naïf de croire en une autosuffisance présumée des marchés dans leur fonction dallocation des ressources, indépendamment de toute éthique" écrivait en 1987 le Pape Jean-Paul II dans sa Lettre Encyclique « Sollecitudo rei socialis »... "Les marchés ont besoin de directives solides et fortes, macro-prudentielles aussi bien que normatives, qui soient uniformes et partagées par le grand nombre" dont les "règles doivent aussi être continuellement mises à jour, vu la réalité même des marchés constamment en évolution" constate un autre texte du Vatican faisant autorité, Considérations pour un discernement éthique sur certains aspects du système économique et financier actuel. Ainsi, la réflexion proposée le 28/4/2025 par E&I tombe-t-elle à point nommé : l'idéologie dominante, derrière les appels au "laissez-faire" actuels sont une résurgence. Celle d' "un égoïsme aveugle (...) limité au court terme ; faisant fi du bien commun, il exclut de ses horizons la préoccupation non seulement de créer mais aussi de partager la richesse et déliminer les inégalités aujourdhui si aiguës." Certes, "il revient dabord aux opérateurs compétents et responsables délaborer de nouvelles formes déconomie et de finance dont les pratiques et les règles visent le progrès du bien commun ainsi que le respect de la dignité humaine" rappelle le texte du Vatican. Et aussi, qu'il appartient "à tout-un-chacun, de participer à cette fin aux réalités du monde." De même, plusieurs éthiciens le soulignent, par exemple D. Bonhoeffer : " Ce nest que dans la participation à la réalité que nous avons part au bien".
Il est crucial dêtre de "ceux qui contribuent à un ordonnancement interactif et évolutif des règles et à une harmonisation des valeurs autour de lesprit qui les inspire" professait avec une belle hauteur de vue la juriste et philosophe Mireille Delmas Marty***. La tâche est colossale, c'est "l'affaire de tous". Mais, comme dit un proverbe fameux : "qui ne tente rien... n'a rien". Alors, restons unis pour continuer de réfléchir, de nous former, d'interpeller entreprises et pouvoirs publics : les principales missions d'E&I depuis sa fondation. Prochaine soirée-débat : le 25/11/2025/
Michèle Royer,
chargée de mission d'E&I
* source : Rapport Drahi
** source : Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de lEurope in Les Echos du 30 janvier 2025 p.06, article intitulé : "L'Europe doit être être un peu plus carnivore" (vis à vis des autres Nations, nos compétiteurs...)
*** source : Mireille Delmas Marty, Entre les règles et l'esprit des règles, 2021 https://shs.hal.science/halshs-03494395v1

Plutôt que se contenter dentériner le passé, oser la réflexion à long terme

Souvent, la comptabilité est comparée à un coup d'il dans un rétroviseur.
« Jai toujours eu le sentiment que la comptabilité nétait pas dabord faite pour analyser le passé mais plutôt pour prévoir lavenir* ». A la faveur d'échanges avec ses pairs, lors de rencontres dont Nicole Reille nétait pas avare, elle en arrive à concevoir « Pour répondre à leur demande (
) un programme informatique qui permettait de faire rapidement la projection démographique dune Congrégation sur 25 ans et dy adosser les paramètres permettant de mesurer létat des recettes et des dépenses de fonctionnement sur la même période ». La PLT, « Prévision Long Terme » aujourdhui encore dispensée par E&I est née !
Nouveauté : lAssociation Éthique & Investissement (E&I) sappuie depuis mai dernier sur Corref & Cie pour déployer auprès des congrégations accompagnées dans le cadre de ses missions spécifiques, notre outil de prévision de long terme (PLT). Cet outil destiné -dès l'origine- aux communautés/congrégations religieuses répond à la question : « avons-nous assez d'argent pour assurer durablement la vie des membres de la Congrégation et sa mission ? ». Il a été mis au point par Sr Nicole Reille, notre fondatrice, puis perfectionné pendant 15 ans par Pierre Arquié (ancien DAF de la congrégation ND des chanoinesses de St Augustin, membre du conseil d'administration dE&I).
Sachant maintenant que Corref & Cie intervient auprès des congrégations en fin de vie et que, dans ce cadre, ses missions d'audits et d'accompagnement peuvent la conduire à avoir besoin de connaître et/ou utiliser cet instrument, E&I la mis à sa disposition, aux termes d'une Convention. Car il peut répondre au besoin précis de ces congrégations qu'elle accompagne, qui ne sont plus, par définition, aptes à se former auprès dE&I directement ni à se doter par elles-mêmes de cet outil. Il a fait ses preuves depuis son invention par la fondatrice dE&I en effet.
A noter, pour les congrégations encore autonomes qui choisiront de sen doter Pierre Arquié continuera de dispenser la formation à la PLT et de les accompagner. Pour elles, les inscriptions à la PLT diffusée par E&I, via les services assurés fidèlement par Pierre Arquié depuis plusieurs décennies maintenant, seront ouvertes comme de coutume ! A suivre ici
* Nicole Reille, Croquer la vie à pleines dents, 2010
Michèle Royer
chargée de mission

Un bouquet de questions écrites aux AG 2025 du CA40... un peu suranné :(

"Nous voulons des faits concrets. Pas du baratin" de la part des entreprises sollicitant notre argent ; provoquant le dialogue avec les responsables économiques et politiques, "Nous ne nous érigeons pas en juges, mais nous cherchons à écouter leurs difficultés, leurs contraintes, et à les encourager dans les pas qu'ils peuvent faire pour que l'économie devienne plus humaine, plus attentive aux personnes". Tels sont les mots de Sr Nicole Reille dans le livre* qu'elle a écrit pour relater son parcours, l'origine et la raison d'être d'Éthique et Investissement, créée en même temps que le fonds NS50 (alias, Nouvelle Stratégie 50) parce que, stipule-t-elle, "Dans un contexte d'économie mondialisée où nous sommes tous interdépendants, l'évangile a aussi quelque chose à voir avec la Bourse".
L'idée de ce fonds alors conçu comme fonds de pension pour abonder les ressources, à plus long terme, des souscripteurs dont, notamment, des congrégations qui y investissent une part de leurs réserves en vue de leurs "vieux jours" est combinée avec celle d'exercer un droit de regard légitime, quand on est propriétaire de parts, sur la manière dont l'entreprise se comporte. D'où un questionnement régulier, actualisé, avec leurs dirigeants ; ce qui fut fait dès les années 80, pour AirFrance, Carrefour, BSN ou pour Total à propos de la Birmanie, ou encore Lafarge ciments dirigée par B. Collomb dont la politique anti-pollution avant-gardiste l'avait "édifiée" (par ex. cf Le Parisien du 14/1/1992). Une manière d'investir alors pionnière en France, mise en place et exercée sous la houlette de nos fondatrices, à travers ce fonds commun de placement (FCP) d'un genre inédit, à l'époque.
Autres temps, autres formes d'un questionnement aujourd'hui reconnu et encadré
L'un des moyens du dialogue actionnarial, au moment des AG (Assemblées Générales) des sociétés cotées consiste à poser des "Questions Écrites". La saison est en cours : la campagne 2025 de la plateforme d'engagement du Forum pour l'investissement responsable bat son plein. Parmi les questions retenues et portées par ce collectif multi-parties prenantes, il y a cette question écrite, posée en bonne et du forme à BNPP (qui prolonge l'interpellation initiée par E&I fin 2024). Question retravaillée et ciselée, sous l'angle de l'éthique des affaires, à savoir :
"Le G de gouvernance est un pilier de lISR qui implique de veiller au strict respect par soi-même et ses parties prenantes tant des lois et règlements en vigueur que de léthique des affaires. Or, des dossiers délictuels sont en cours, instruits notamment par les parquets financiers de la France et du Portugal, sur le cas dAltice que BNPP conseille et finance ainsi que ses dirigeants, depuis plus de vingt ans, tout en incitant ses clients et correspondants à y investir.
a) Le Code de conduite de la banque est-il adapté pour la protéger de ce type daffaire ? Merci de justifier votre réponse.
b) Dans le cas où les faits évoqués révèleraient des failles dans le Code de conduite de la banque, cela a-t-il conduit, ou est-il susceptible de conduire, BNPP à le réviser afin déviter que ne se reproduisent des cas similaires ? Merci de préciser votre réponse.
c) Dans le cas où des améliorations sont envisagées, comment entendez-vous y associer les parties prenantes de la banque ?
d) BNPP envisage-t-elle, pour protéger ses parties prenantes (clients, déposants et actionnaires), de se porter, à linstar du groupe Altice lui-même, partie civile dans les dossiers délictuels en cours ?"
Réponse de l'intéressée (enfin, si l'on peut dire...) au dialogue actionnarial en question tenté lors de cette AG : l'enregistrement vidéo de l'AG 2025 figure bien sur le site de l'entreprise, comme le préconise le régulateur. Elle est censée durer 3h. Les séquences montrant les résultats excellents, des exemples d'actions RSE exemplaires accompagnées par la Banque avec, le cas échéant, le nom de ses clients concernés sont accessibles, sans en perdre une miette ; mais au moment des Questions Écrites, l'enregistrement "zappe" cette séquence pour débouler sur la suivante (vote des résolutions et mots de la fin). Subtile coupe à peine perceptible, sauf que le "compteur" ripe de 1:35 env à 2:48, direct ! **
Or, selon l'AMF Posez des questions et exprimez-vous :
"Si vous manquez d'éléments (
) vous pouvez interroger la société. Vous avez le droit de poser toutes les questions nécessaires pour éclairer votre vote.
Vous devez envoyer vos questions au siège social de lentreprise au plus tard 4 jours ouvrés avant lassemblée générale, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique. Joignez-y une attestation dinscription dans les comptes-titres, délivrée par la société cotée ou votre intermédiaire financier selon votre statut, prouvant que vous êtes bien actionnaire de la société. Le conseil dadministration est tenu de vous répondre :
* soit par écrit, sur le site internet de la société, avant la tenue de l'assemblée générale,
* soit par oral, au cours de l'assemblée générale.
Vous pouvez également poser vos questions directement lors de lassemblée générale."
Source : https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/etre-un-actionnaire-individuel/comprendre-et-voter-en-assemblee-generale
Vis à vis des Questions d'actionnaires, de toute évidence, voilà une ... réponse (?), plutôt cavalière. L'art de "botter en touche" plutôt que l'art du dialogue pourtant "consubstantiel" à la RSE, en principe à l'écoute de ses différentes "parties prenantes", est en l'occurrence patent. Ce recul, quant à la place des parties prenantes, source d'inspiration des politiques d'entreprise dans l'histoire de la RSE est de piètre augure.
* Nicole Reille, Croquer la Vie à pleine dents, nov. 2010 ISBN : 978-2-9542014-1-2
** intégralité de l'enregistrement rétablie début juin ... après la 1ère mise en ligne de cet article
Cet article a été mis ligne le 29 mai 2025 puis mis à jour le 10 juin suivant.
Michèle Royer
chargée de mission

Rendre des comptes : l'impossible exercice ?
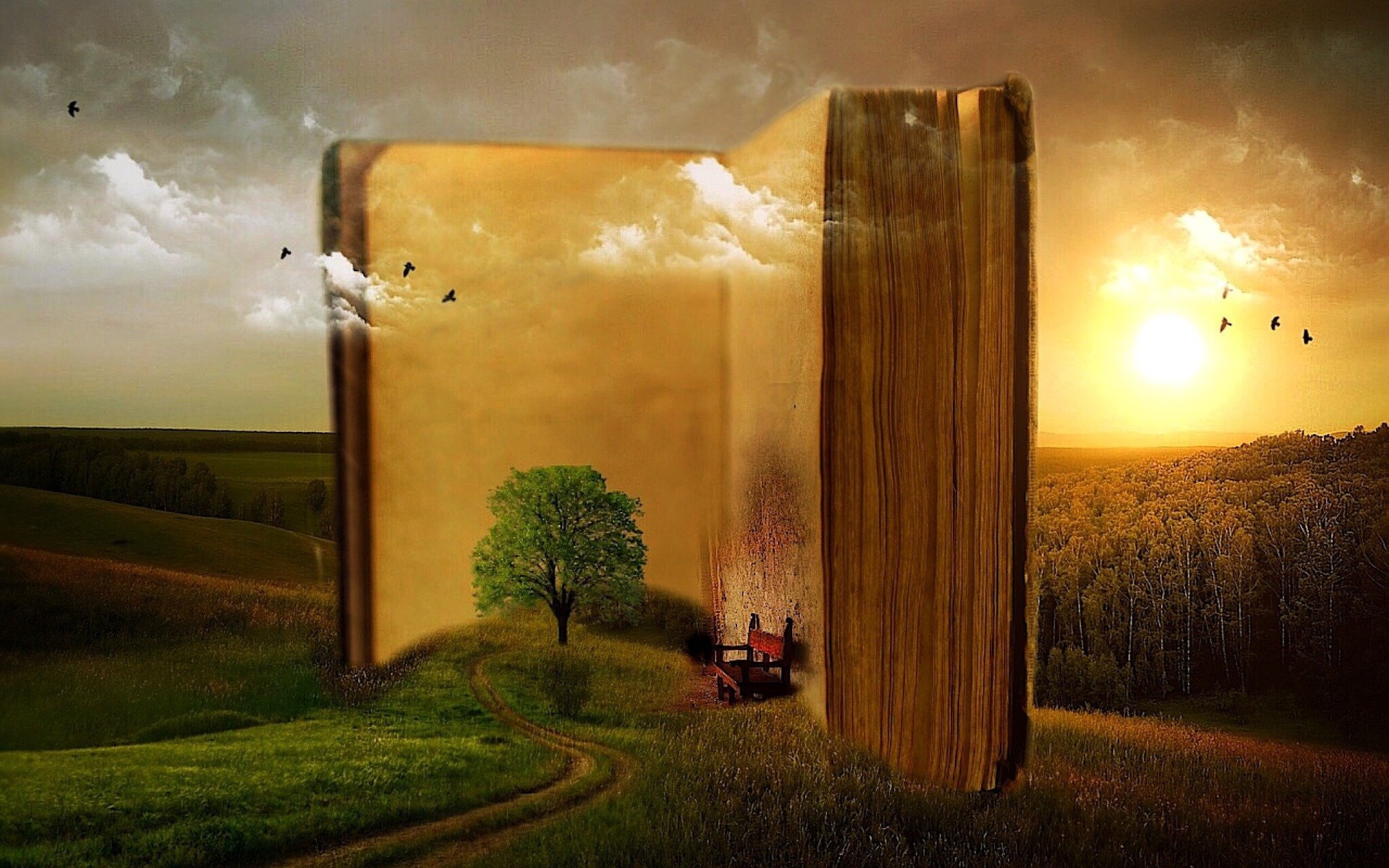
L'obligation de reporting sur les critères E,S,G, étendue peu à peu à l'ensemble des chaînes de valeur, cauchemar de certaines entreprises à ce que l'on entend : CSRD, C3D seraient d'exécrables exercices bureaucratiques sur lesquels l'UE ferait bien de revenir, de "revoir sa copie" ! C'est pourtant, très largement, sur les brisées de ces démarches de reporting qualifié jusqu'ici, le plus souvent, d' "extra-financier" que les décisions des investisseurs engagés font florès ; par exemple, les décisions de notre association lors des Comités éthiques statuant sur l'univers d'investissement du fonds NS50 (archivées ici).
Or, la nécessité de ce reporting, en tant que source d'informations utiles à l'actionnaire et à toute autre "partie prenante" responsable, est justifiée par le besoin d'être éclairé sur les politiques et stratégie, notamment à long terme, de ces "personnes morales" que sont les entreprises, -au moins pour celles faisant appel à des financeurs, au "marché"-.
Elle pourrait connaître un virage, comme récemment le "titrait" un colloque accueilli à l'Assemblée Nationale par le député Dominique Potier, père de la loi française sur le devoir de vigilance. A la clé de la régulation vouée actuellement aux gémonies, bien qu'applicable depuis peu dans l'ensemble de l'UE, ces sources d'information règlementaires sont notamment destinées à renseigner les investisseurs, mais aussi, à engager puis nourrir un dialogue entre l'entreprise et l'ensemble de ses "parties prenantes". Elle commence à peine à entrer en vigueur à cette échelle, qu'un brusque "retour de bâton" se profile à l'horizon à l'occasion de la proposition de directive dite Omnibus. Pourquoi ? D'autant que cette dernière fait irruption dans un climat international plus vaste de réactions (au moins verbales) à un certain nombre d'avancées dont l'univers de la finance responsable pouvait se targuer. Selon Morningstar en effet,« Les actifs combinés des fonds relevant de larticle 8 et de larticle 9 ont atteint 6 100 milliards deuros, soit 60 % de lensemble du marché des fonds de lUE » (Hortense Bioy, le 05/02/2025)
Pourquoi tant de hâte à faire marche arrière ?
« LEurope continue de dominer le marché des fonds durables », selon un autre article de Morningstar daté du 02/02/2025 : « les actifs des fonds durables mondiaux ont atteint un niveau record de 3 200 milliards de dollars à la fin de 2024, soit une augmentation de 8 % par rapport à lannée précédente et une taille plus que quadruplée par rapport à 2018. LEurope reste le principal marché, abritant 84 % des actifs. Les États-Unis sont tombés à 11 % en 2024, contre 15 % en 2018. La part de marché des fonds durables du reste du monde a augmenté pour atteindre 2,3 % en 2024, contre un pourcentage négligeable de 0,7 % en 2018 ». Bref, malgré les critiques, utiles garde-fou contre les déviances (éco-blanchiment, mésusage des normes comme le Père Perrot l'explique dans l'un des entretiens vidéo sur notre chaîne Youtube), entre autres "mascarades" toujours à redouter, bien sûr, il y a là sans doute un acquis, voire un atout, à tout le moins une caractéristique à tourner à notre avantage plutôt que de le piétiner rageusement ?
Dans ce contexte, Éthique et Investissement a choisi le thème de sa soirée-débat programmée le 28 avril prochain : "face à la levée de boucliers de ses adversaires (backlash) faut-il continuer à réglementer l'ESG ?"
Autour de :
Corinne Lepage avocate, ancienne ministre de l'environnement et ancienne eurodéputée;
Cécile Ezvan, professeure d'éthique et de RSE à Excelia BS, chercheuse associée au campus de la Transition, administratrice d'EBEN et du RIODD
Murielle Cagnat Fisseux, DG de Stella Partners (un cabinet axé sur la RSE) et ancienne co-présidente d'un comité du Medef sur l'excellence opérationnelle
après une introduction du Président d'E&I, Jérôme Courcier, qui s'inspirera du tableau de Rembrandt intitulé Saint Paul en Prison
Inscriptions préalables ici : https://www.helloasso.com/associations/ethique-et-investissement/evenements/faut-il-reglementer-l-esg-ecologie-social-gouvernance
Michèle Royer
chargée de mission d'E&I

Quelle éthique pour mes placements, quels placements pour mon éthique ?

Une nouvelle initiative de l'association Éthique et Investissement tend à compléter le panorama des formations existantes, cette fois, à destination de tout public (épargnants individuels, actionnaires, investisseurs) soucieux de ne pas se gargariser de mots (éthique et morale, quelle différence ?) mais d'appréhender en l'occurrence, le sens de l'éthique en finance.
Au programme, est également prévue une séance de "décodage" de quelques véhicules financiers encensés à cette aune. Par exemple, seront analysés une sélection de fonds que le magazine Challenges a récemment promus comme étant "les meilleurs fonds d'investissement pour un monde meilleur" (octobre 2024)... Bigre !
La matinée du 30 avril prochain sera donc consacrée aux fondamentaux de léthique (quest-ce que ce mot recouvre et implique ?) et l'après-midi dédié au décryptage de la documentation des fonds dinvestissement (notamment, comment distinguer les « passages obligés » des éléments vraiment significatifs ?).
Contact pour en savoir plus/s'inscrire : info@ethinvest.asso.fr

Mutualiser, s'entraider... : le pari gagnant de Corref&Cie

Première AG de Corref et Compagnie (C&C) le 5 février dernier. Avec, déjà, à son actif, de belles preuves de son utilité effective, qu'Anne de Richecour et Sr Catherine Sesboué avaient pris le temps d'évoquer en notre présence, il y a un an à peine. Cette "filiale" de la Corref (Conférence des religieux et religieuses de France) est née en effet pour favoriser la mise en commun des réflexions, des ressources, des retours d'expérience et des énergies entre les instituts divers et variés, en difficulté ou en expansion, qu'elle connaît bien.
Etat des lieux, entraide, prévision, accompagnement...
"La retraite, ça se prépare ; le vieillissement dun institut religieux aussi ! Cest avec cette conviction que la Corref a créé en juin 2024 lassociation C&C (Corref et Compagnie). Son objectif est double : aider les instituts fragiles ou en fin de vie à prendre soin de leurs membres jusquau bout, et permettre à leurs responsables de prendre les meilleures décisions possibles quant à lavenir de linstitut lui-même. C&C suscite la prise de conscience", sur la base "d'un état des lieux complet" explique cette association catholique, qui représente près de 479 instituts religieux. La Corref assure la représentation de la vie religieuse en France et soutient sa vitalité. Depuis novembre 2008, elle est la réunion de deux conférences distinctes, lune pour les supérieurs majeurs des instituts masculins, lautre pour les supérieures majeures des instituts féminins, apostoliques et monastiques."
D'où, des réalisations (abouties ou en cours de déploiement) que la toute première Assemblée générale (AG) de cette initiative novatrice a illustré, de manière sensible. Tact et bonne humeur étaient au rendez-vous !
Les actions relèvent des thématiques telles que :
- « Avoir un regard éclairé sur mon institut »
- Favoriser la prise de conscience
- Être un tiers facilitateur au sein de linstitut
- Aider à réaliser des projections démographiques et financières
- Réaliser des audits/états des lieux des instituts
- Aider à la prise de décision
Il s'agit, chaque fois, d'épauler, souligne Véronique Margron en présentant la finalité de C&C. Pour accompagner les religieux dans les instituts en fragilité, notamment, C&C compte aussi sur le fonds de partage "Porteurs d'espérance" qui fait de C&C l'un de ses bénéficiaires.
A date, retrouvez ici des témoignages, parfois poétiques, toujours véridiques. Et même, une offre d'emploi. Bravo !
Michèle Royer
chargée de mission E&I

Des expériences croisées, pour un enrichissement mutuel

Sr Nicole Reille, fondatrice dÉthique et Investissement en 1983, alors Économe de la Congrégation Notre-Dame des Chanoinesses de St Augustin, a souhaité une présence significative de religieux/ses y compris dans le Conseil dAdministration jusquà préciser ce point, dès le départ, dans les statuts de lassociation. Quelle est lutilité dune telle exigence ?
Les économes nont pas toujours de connaissances particulières dans le domaine financier mais rencontrent les professionnels de la finance dans le cadre de leur fonction. Certains dentre eux imaginent ce dont ces client(e)s atypiques pourraient avoir besoin mais leur approche plus marketing que de « conseil désintéressé » pose question. Dautres se présentent comme « spécialistes de la doctrine sociale chrétienne » (DSE) et proposent des solutions toutes faites qui gênent sérieusement la réflexion nécessaire en vue dune démarche éthique responsable.
Loin des solutions toutes faites, figées ...
Soutenus et encouragés par notre Association les religieux accèdent peu à peu à une plus grande autonomie grâce aux formations proposées, aux rencontres et réflexions entre membres, experts de la finance et professionnels, grâce aux Ateliers Éthiques et aux publications dE&I
Toutes ces propositions napportent pas de solutions ni de réponses toutes faites, mais aident chacun(e) à se faire une opinion et pouvoir choisir ses produits financiers en connaissance de cause.
Un partage d'expériences au sein d'E&I entre laïcs et religieux, enrichissant
Vivant des engagements au cur la société, en proximité avec les populations les plus pauvres et les plus fragiles, les économes ont aussi lexpérience de la mise en commun des biens, et cherchent de cette manière à résister à un capitalisme qui ne chercherait que le profit, cela les amène à interpeller les professionnels pour quils se mettent à lécoute de leurs préoccupations, de leurs besoins et de leur charisme.
Entre membres de lassociation, un dialogue fécond sinstaure à partir des diverses expériences des uns et des autres, laïc ou religieux, chacun partage son approche, ses compétences, pour un enrichissement mutuel. Nous ne pourrions pas nous passer les uns des autres !
Christiane Vanvincq & Marie-Thérèse Thibaut, Administratrices d'E&I

Comité NS50, une rentrée prometteuse
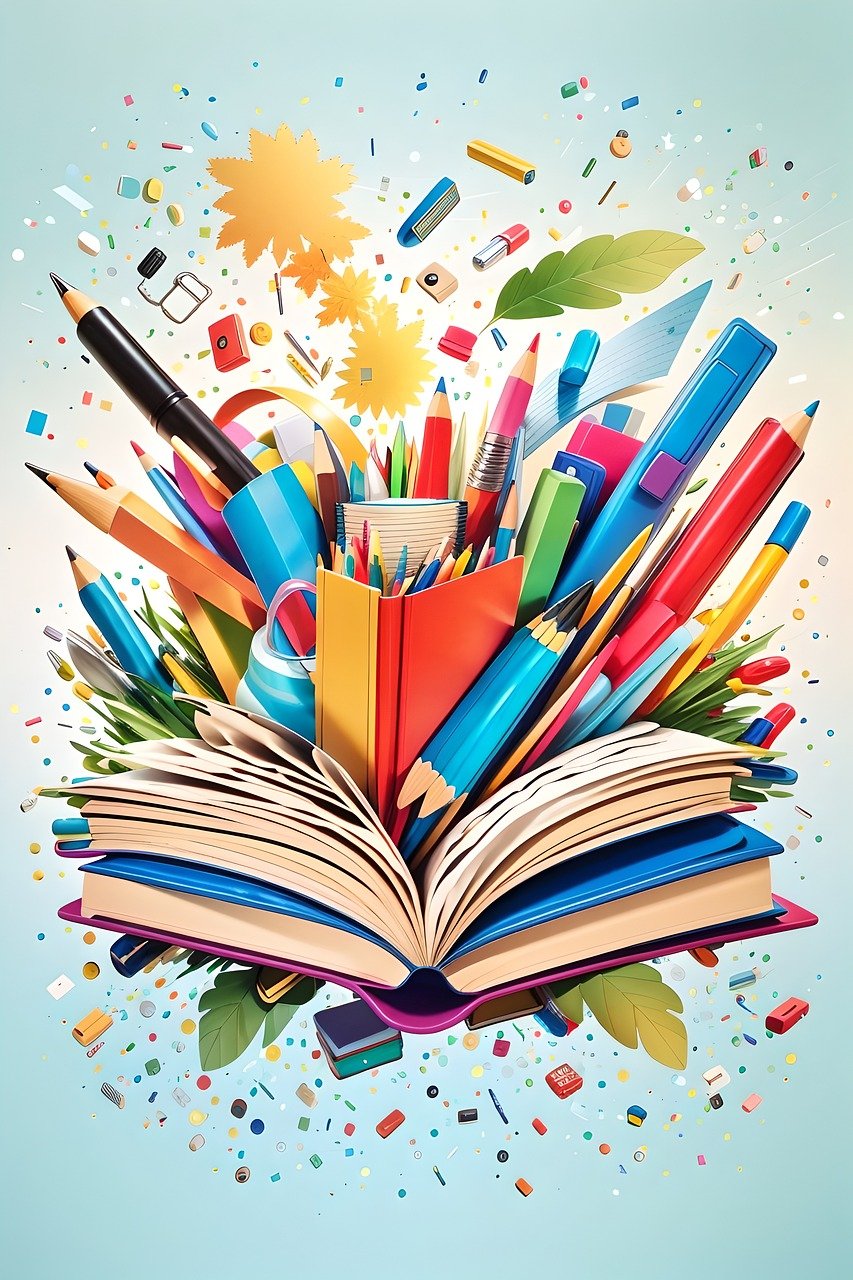
Objectif de notre comité NS50 : statuer sur les valeurs admises ou non dans lunivers dinvestissement du fonds Nouvelle Stratégie 50 (NS 50).
Depuis la création de ce produit financier, en même temps que la fondation de notre association, Éthique et Investissement, par quelques Économes de congrégations religieuses, pionnières en Europe, ce comité se réunit régulièrement afin de passer en revue les entreprises à admettre, à exclure ou à conserver au sein de l'univers d'investissement du fonds NS50. A ce titre, cest un fonds ISR pionnier.
Nouveau protocole depuis octobre
Entre juillet et décembre 2024, ce comité auquel participent régulièrement au moins trois représentants dÉthique et Investissement sest réuni une première fois en octobre sur la nouvelle méthodologie danalyse ISR de Mandarine Gestion. Puis deux autres fois pour examiner les entreprises pré-sélectionnées à l'aune de leurs performances extrafinancières, dans leur secteur. En l'occurrence, les émetteurs spécialisés dans les :
- Services aux collectivités : Énergies
- Services aux collectivités : Eau et Déchets
Nos décisions, arguments à lappui, sont lobjet dun compte rendu. Comme de coutume, ce compte rendu s'ouvre par une contextualisation du secteur considéré ; il se poursuit par le relevé des décisions prises par E&I pour les entreprises admises/exclues ou conservées dans lunivers des valeurs « investissables », propre au fonds NS50. Ces compte rendus sont adressés par courriel à nos adhérents qui en ont ainsi la primeur, dans lune de nos publications intitulée : La Communication économique et financière dÉthique et Investissement (« ComEcoFi » dE&I).
Une rentrée haute en couleurs et riche de promesses...
Comme annoncé dans notre précédente Newsletter, les équipes de Meeschaert -racheté par LFPI, puis fusionné avec Mandarine gestion- ont emménagé dans de nouveaux locaux, et se sont organisées dans ce nouvel ensemble. Doù une coupure estivale plus longue qu'auparavant, le temps pour ces équipes de sinstaller.
Les entreprises qui nous sont dorénavant présentées sont sélectionnées sur la base de :
- leur score ESG, un score tenant compte de la note du prestataire habituel (Sustainalytics) certes, mais ensuite affiné en interne selon une méthodologie propre à léquipe danalystes extra-financiers de Mandarine Gestion,
- et/ou de lintérêt manifesté par le gérant responsable de ce fonds.
Avec ce nouveau protocole, le nombre d'entreprises passées en revue est réduit par rapport à la méthode précédente. Cette évolution a une ambition : permettre des analyses plus approfondies, sans perdre de temps sur le cas d'entreprises qui nont aucune chance dêtre réellement investies car présentant peu d'intérêt aux yeux du gérant. Par ailleurs, considérant les frais de gestion inchangés depuis longtemps, il pourrait y avoir aussi du nouveau à lavenir : à suivre...
Pierre Chardigny, Administrateur d'E&I
et Michèle Royer, chargée de mission d'E&I

Un acte d'engagement actionnarial, pour l'exemple

Notre interpellation, lancée lors de la Semaine de la Finance Responsable sur l'engagement actionnarial 2024 contient, implicitement, une préoccupation clé :
Pourquoi les investisseurs responsables sont-ils invités à questionner BNPP au sujet dAltice ? Les banques universelles, comme BNPP qui est la première banque européenne avec un bénéfice annuel de 10 milliards deuros, sont au centre du monde de la finance actuelle.
Un modèle sujet aux conflits d'intérêts
Sur la base des réseaux traditionnels de crédit et de dépôt, elles ont développé en sus de ces derniers, grâce à la déréglementation européenne des années 1980 et labrogation en 1999 de la loi américaine Glass-Steagall, un rôle dominant tant dans le négoce de valeurs mobilières que dans la gestion de titres, la banque d'affaires, les assurances et limmobilier, et ce, grâce aussi à la « garantie implicite » des États.
Cette dernière leur a en effet permis de pénétrer avec moins de risque ces nombreux secteurs, sources de revenus alternatives aux crédits et dépôts classiques, et, dans un contexte déconomies déchelle, daccroître leurs opérations financières avec les grands groupes, les seuls à même dutiliser fréquemment leurs services de conseil en fusions-acquisitions et de financement desdits rachats d'entreprise, aux dépens des services de crédit ou de dépôt des clients plus modestes.
... et qui pose la question éthique de savoir si la rémunération du risque revient bien à qui porte le risque
La gestion des multiples conflits dintérêts générés par la multiplication des opérations de financement, dinvestissement et de conseil avec les grands clients étant laissée aux banques et à leurs responsables de conformité, ce modèle met lenrichissement rapide des grands acteurs choyés par les banques universelles à la charge de la grande masse des déposants, par ailleurs bridés dans leurs demande de prêts bancaires.
Le groupe Altice-Drahi, qui est devenu le client numéro un de BNPP, est un cas révélateur des défauts de ce régime. Il a en effet obtenu en 20 ans, pour ses acquisitions dans le secteur des télécommunications, un financement global atteignant 60 milliards deuros. Dans le même temps, il a réduit lemploi de milliers de personnes en France et au Portugal, et son PDG, Patrick Drahi, qui vit en Suisse et paie peu dimpôts, est devenu multimilliardaire.
Un cas emblématique, épineux à l'aune de la RSE des acteurs du secteur financier
Comme en 2023 plusieurs cadres dAltice ont été arrêtés puis mis en examen au Portugal puis en France pour divers délits financiers, la faveur de BNP-PARIBAS pour ce groupe et son fondateur semble contraire aux règles d'éthique auxquelles la banque prétend se conformer. De plus, ce groupe manquant depuis quelques années du cash-flow nécessaire au service de son énorme dette, il est fort probable que les fonds d'investissement à qui les banques, comme BNPP, ont transféré le risque Altice ne soient que très partiellement remboursés, occasionnant ainsi une perte aux modestes retraités et contribuables au profit du PDG et actionnaire dAltice, un résultat là aussi contraire aux objectifs du Code de conduite de la banque.
Un enrichissement personnel aux dépens des services de crédit et de dépôt des clients les plus modestes ?
Compte tenu de ces faits, et alors que les ministères portugais et français de la justice continuent denquêter sur déventuelles malversations de la direction dAltice, il apparaît nécessaire que pour la protection de ses actionnaires, clients et correspondants, BNPP se porte partie civile aux procès en cours. C'est l'objet de la question écrite de l'association Éthique et Investissement, adressée à BNPP. Tous les éléments du dossier étayé sont à retrouver ici
A noter, par ailleurs, que notre publication périodique intitulée "La Communication Ethique et Financière d'E&I" consacre un numéro double à l'analyse du secteur "Banques et Services Financiers" (d'ores et déjà adressé à nos adhérents), qui sera prochainement archivé ici.
Jérôme Courcier, Président d'E&I
Pierre-Henri Leroy, Administrateur d'E&I

Des nouvelles de quelques partenaires d'E&I, de longue date !

Seul(e) au monde ? Non, bien sûr ! Nos idéaux d'investissement aptes à transformer l'économie, pour une "vie bonne" ici-bas, en société -à rendre toujours "plus humaine"- animent aussi d'autres réseaux, dont certains sont nos partenaires, de longue date. Tournons nos regards vers quelque-uns d'entre eux, à l'occasion de la rentrée, avec son lot de nouvelles et d'évènements à l'horizon, pour les relayer et inspirer... une bouffée d'optimisme ?
Un état d'esprit bien nécessaire en l'occurrence comme l'exprime l'ICCR, dont notre fondatrice Nicole Reille s'était rapprochée (elle mentionne dans son autobiographie que c'était l'un des rares réseaux, à l'époque, à porter déjà des préoccupations proches de celles présidant à la création d'Éthique et Investissement) en titrant son Congrès de ce 19 septembre 2024 : "Navigating troubled waters : corporate political responsablity in turbulent times". Drôles de temps, en vérité ; de ce fait, les hérauts de la RSE/CSR (responsabilité sociale et environnementale) sont appelés à redoubler d'efforts, d'imagination et de clairvoyance pour "s'assurer que leurs actions politiques -au sens large du terme- contribuent à renforcer une démocratie solide et dynamique".
Amérique, Europe et France dans le viseur de notre partenaire Québécois
Naviguer, gouverner en eaux troubles, dans un climat de turbulences...Tel est à présent le contexte selon l'Interfatih Center on Corporate Responsability (ICCR) à l'orée de son Congrès 2024, organisé à Manhattan (NYC). Autre partenaire de longue date d'E&I, Outre-Atlantique également mais ancré plus au nord (Canada), le Regroupement pour la responsabilité sociale des Entreprises (RRSE) relaie cet évènement dans sa dernière "Lettre aux membres" (Newsletter de la rentrée), parmi d'autres "nouvelles aux membres" fort instructives, témoignant d'une large ouverture sur le monde.
Elle nous apprend ainsi que "Le rôle mondial du Canada en matière d'entreprises et de droits humains" sera le thème d'un Symposium "à ne pas manquer" le 29 octobre à Ottawa, organisé par le Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises (RCRCE). Ce réseau milite en faveur d'une loi en la matière, canadienne. Cet été, pour l'UE, a été publiée au Journal Officiel de l'UE, une directive en ce sens (le 5 juillet 2024 avec une "entrée en vigueur" le 25 de ce même mois estival) est-il rappelé dans la newsletter du RRSE.
De même, elle braque un projecteur sur l'imminence d'un lien entre la protection de l'environnement et la protection des droits humains fondamentaux, qui pourrait faire jurisprudence, de la part de la Cour européenne des Droits de l'Homme, aux dépens du gouvernement norvégien. En effet, dans cette même publication de rentrée du Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprise (RRSE) est annoncée la conclusion prochaine "d'une action historique de jeunes ayant porté le forage pétrolier arctique devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme : les plaignants soutiennent que les actions du gouvernement en question violent les droits à la vie et à la vie privée protégées par la Convention européenne des droits de l'Homme". Un précédent très attendu, "pour renforcer la justice climatique au niveau mondial".
Lutte contre le greenwashing : des investisseurs ligués d'un continent à l'autre...
Aux yeux de nos homologues canadiens, les récents appels adressés à l'AMF française pour plus de vigilance et de vraies sanctions destinées à éradiquer l'écoblanchiment ne passent pas inaperçus. Tant la tribune de personnalités (d'ONG et du monde académique) que la polémique autour de la pseudo-sanction (un accord de type amende contre arrêt des poursuites) à l'encontre d'une société de gestion, "inédite" -pour manquements en matière de durabilité-, rendue publique par l'autorité de régulation française.
Le "laxisme" dénoncé en France, l'est aussi au Canada, notamment, à l'encontre de grandes banques accusées là-bas de "fournir des informations trompeuses sur leurs activités en matière de finance durable". (Pour en savoir plus : ici.)
Ah ! si tous les réseaux du monde... Réseaux d'acteurs responsables, s'entend :)
La rentrée, c'est aussi le temps des bonnes résolutions, et notamment, celle de se "retrousser les manches" ?
Chez nous, du 25 septembre au 5 octobre, la semaine de la finance responsable proposée par le FIR, qui s'adresse chaque année au "grand public" (épargnants/investisseurs), sera axée sur un thème cher à E&I, depuis ses origines : le dialogue actionnarial.
Michèle Royer,
chargée de mission
E&I

Favoriser une éthique appliquée à l'"Intelligence Artificielle"
Hasard du calendrier ou Providence, le même jour que notre soirée-débat à propos des enjeux éthiques de l' "IA", ce 30 avril 2024, l'Appel de Rome (pour une éthique de l'"Intelligence Artificielle ") enregistrait un nouveau co-signataire en la personne de larchevêque de Canterbury, chef de la Communion Anglicane, Justin Welby, lors dune cérémonie au Vatican.
Cet Appel, comme rappelé dans le Livret remis aux participants de la soirée-débat d'Ethique et Investissement, s'est assigné pour objectif de favoriser une culture commune "capable de veiller à ce que cette technologie serve le bien commun et la sauvegarde de la maison commune". Sont co-signataires depuis 2020 : le rabbin Eliezer Sima Weisz, le Cheik Abdallah bin Bayyah, Brad Smith (Microsoft), Dario Gil (IBM) Maximo T. Cullen (FAO) ; ils s'accordent à défendre des principes ayant trait à la transparence, linclusion, limpartialité, la fiabilité, la sécurité et du respect de la vie privée que "les IA" ne devraient pas bafouer.
Un enjeu colossal
Cette initiative alerte sur l'urgente nécessité d'une éthique appliquée aux algorithmes, pièce maîtresse des « outils » dotés d « intelligence », certes « artificielle » (IA), cest-à-dire en mesure de produire du renseignement (cest le sens du mot anglais « intelligence », comme dans « CIA ») généré grâce à des digesteurs de données de plus en plus « puissants », si lon considère les calculs statistiques effectués de manière automatique, dans ce système.
Sur un ton ni anxiogène, ni apologétique et en termes simples : un historique et une typologie (de Xavier Drouet) sont consultables ici.
De tels systèmes "truffés" d'IA «sont partout, constate Aurélie Jean. Elle précise, dans son livre "Algortihmes, bientôt maîtres du monde?" : « On ne les trouve pas que dans les réseaux sociaux, mais aussi en médecine, dans nos modes de transport, de communication, dans la finance, léducation, la construction ». Partout, autrement dit « ces technologies ont le potentiel de remodeler notre façon de travailler, dinteragir et de vivre ; dêtre humain en somme » (Geoffroy de Vienne, Président dEthique et Investissement).
Quest-ce que "lIA" ?
Elle fait couler beaucoup d'encre et sera encore dactualité prochainement : « lIA » est à lordre du jour du G7 de juin 2024 en Italie, Sommet de chefs d'Etat auquel a prévu de participer le Pape François. La Présidente du pays hôte sen réjouit, mentionnant lIA comme « le plus grand défi anthropologique de cette époque». «Une technologie qui peut générer de grandes opportunités mais qui comporte aussi d'énormes risques et qui affecte inévitablement les équilibres mondiaux» rapporte Vatican News, qui relaie la nouvelle. « Le risque est que les critères qui sous-tendent certains choix deviennent moins clairs, que la responsabilité de la prise de décision soit dissimulée et que les producteurs puissent se soustraire à lobligation dagir pour le bien de la communauté » poursuit la Présidente italienne estimant que « le système technocratique, qui allie léconomie à la technologie et privilégie le critère de lefficacité, en ignorant tendantiellement tout ce qui nest pas lié à ses intérêts immédiats » et c'est un accélérateur de poids.
Le fait est est que des machines auto-« apprenantes », dont la sophistication est lun des apanages, carburent grâce à des données, de plus en plus volumineuses, et elles sont de mieux en mieux « armées » pour retourner un résultat qui peut avoir les atours dune « décision » en lieu et place dun esprit humain. On dit quelles le font de manière « autonome » comme autrefois on a pu nommer, avant l'heure, les voitures motorisées d'objets « automobiles » (étymologiqment : qui se meut de manière autonome) ? Sauf que celles-là ne pouvaient se passer de chauffeur pour aller d'un point A à un point B Tandis quavec lIA, pas sûre que le pouvoir de décision humaine ne soit pas déjà entamé à un point inédit. Le sociologue Gérald Bronner dans sa chronique du 4/4/2024 parue dans l'Express, titré "Qui blâmer si des décisions calamiteuses sont prises par l'IA?" rapporte qu'une "firme polonaise présente dans 60 pays a révélé avoir mis à sa direction une IA nommée Milka (...) Il ne s'agit pas du 1er PDG artificiel" ajoute-t-il, en citant de plus, une entreprise chinoise, NetDragon Websoft...
Certes, "tendance nest pas destinée" comme le scientifique écologiste, inspirateur avec Barbara Ward du 1er Sommet de la Terre onusien à Stockholm en 1972, René Dubos, avait coutume de le dire de son vivant (1901-1982). Mais gare, l'inclination en l'occurrence a un poids d'autant plus redoutable qu'elle est plurifactorielle : nous sommes à la confluence de « trois révolutions qui font système et sauto-alimentent » constate Thierry Magnin, membre de lAcadémie des technologies, théologien, président-recteur délégué aux humanités à lUniversité Catholique de Lille. Dans « Penser lhumain au temps de lhomme augmenté », il énumère :
- la révolution de léconomie mondialisée ;
- la révolution du numérique et de linformation ;
- la révolution technoscientifique.
Ajoutant « Nul ne semble en mesure aujourdhui de prévoir avec exactitude ce que le monde devient et deviendra à travers la synergie de ces trois révolutions, avec une impression daccélération qui séduit et effraie tout à la fois. Si nous pouvons reconnaître les avantages majeurs que ces trois révolutions offrent à beaucoup dhommes, dorganisations et de pays ( ) certains redoutent un monde à plusieurs vitesses et de nouvelles formes dexclusions pour ceux qui ne sont pas dans le coup » La charte dinvestissement dE&I tient de tels « impacts » en haut de sa liste de critères électifs. Doù, pensons-nous, un effort de discernement et dengagement à consacrer à ce sujet -parmi tant d'autres, il est vrai-, pour qui ambitionne d'investir de la manière la plus éclairée et responsable possible !
Entre excès dhonneur, et dindignité
"Des algorithmes malins qui permettent à des machines crétines de résoudre des taches complexes". Voilà comment Cédric Villani définit l'intelligence artificielle sur RCF, le 19/10/2018. Et "en même temps", « chaque jour, dans une grande opacité, ils affectent notre accès à linformation, à la culture, à lemploi ou encore au crédit » est-il écrit dans le Rapport qu'en tant que scientifique et député de lEssonne à cette date, il a remis au Premier ministre de lépoque (2018), intitulé « Donner un sens à lIA ».
Pour ce scientifique distingué (lauréat de la plus haute récompense dans sa discipline, la médaille Fields), l'IA est bel et bien « un sujet polymorphe » avec une dimension éthique, laquelle, dans le rapport cité, occupe tout un chapitre, propositions précises à la clé. Par exemple, lidée quil faut réguler ces technologies mais que « la loi ne peut pas tout, entre autres parce que le temps du droit est bien plus long que celui du code. Il est donc essentiel que les « architectes » de la société numérique chercheurs, ingénieurs et développeurs qui conçoivent et commercialisent ces technologies prennent leur juste part dans cette mission en agissant de manière responsable. Cela implique quils soient pleinement conscients des possibles effets négatifs de leurs technologies sur la société et quils uvrent activement à les limiter » (...). « En létat actuel de lart, lexplicabilité des systèmes à base dapprentissage constitue donc un véritable défi scientifique qui met en tension notre besoin dexplication et notre souci defficacité ». Bigre ! Nous sommes les cobayes d'inventions tous azimuts que des apprentis sorciers sans vergogne expérimentent joyeusement... Une situation assez conforme avec le concept de "bac à sable" prévu par la règlementation européenne, prête à autoriser ces inventeurs à ne respecter aucune règle par ailleurs édictées, si c'est à des fins expériementales. Ne pas empêcher la recherche ni les avancées scientifiques, à tout prix, c'est aussi l'un des leitmotiv du Rapport de l'Office Parlementaire de 2017 pompeusement intitulé : "Pour une intelligence artificielle maîtrisée, utile et démystifiée", qui cite Marie Curie : «Dans la vie, rien nest à craindre, tout est à comprendre». Au risque d'en mourir ? Le corps de cette illustre défunte, sans doute victime des radiations qu'elle a découvertes et utilisées sans précaution (dans l'ignorance des effets nocifs, seuls les avantages de cette découverte étaient magnifiés) est contenu aujourd'hui dans un cercueil en plomb car radioactif...
Lexplicabilité des algorithmes,
vue comme lun des garde-fous éthiques
pour accompagner le développement « lIA »
A fortiori avec le « deep learning » (apprentissage dit profond des machines) fruit du langage encore plus « large » mis au point, récemment, et qui « anime » des légions de Chatbots -ces « interlocuteurs » désormais incontournables et plurigénérationnels, cette explicabilité est comme la ligne d'horizon qui s'éloigne, plus on avance... La foi en "l'explicabilité", soit notre capacité à tout comprendre pour peu l'on l'on se donne la peine "d'ouvrir le capot" inspire, dans ce Rapport qui, à la différence de "Notre ambition pour l'IA" (Rapport 2024 au premier Ministre français), s'arrime lui sérieusement à la question de l'éthique, avec quelques injonctions très précises à :
- la clairvoyance, la prudence des « architectes » (où la mixité pêche), quil faut dûment former (et des autres « maillons » de la chaîne de valeur, où leur activité sinsère) ;
- la transparence et son succédané laudit (y compris « citoyen », innovation prônée dans ces pages) où perle un pladoyer en faveur de la « compliance » salvatrice, apte à contrecarrer « lopacité des techniques dapprentissage profond »
Tels étaient les principaux jalons du chapitre sur léthique, dans le Rapport remis au Premier Ministre de 2018. Entre cette date et aujourd'hui, le discours a quelque peu changé : prise de conscience de la vanité de ce concept ? Ou de lobstacle à la course effrénée du progrès que cette condition préalable infère, et par conséquent quil convient doublier, par lâcheté ou, plus vraisemblablement, par amour fou de la science ?
Plus récemment en effet (le 18/12/2023), dans lémission-débat Thinkerview intitulée « IA notre futur assistant ou nouveau maître ? » lexplicabilité a comme "du plomb dans l'aile". Le caractère spectaculaire des prédictions sortant de « boîtes noires » les placent plutôt semble-t-il au-dessus du lot : elles sont « tellement supérieures à ce que les modèles établis » ont fait jusque là, que de bête noire elles accèdent au statut despèce à protéger pour ainsi dire ; rien ne doit entraver la recherche. Plus exactement, le mathématicien voit dans notre propre « surprise » face à ce qui « sort » de ce qui reste à nos yeux des « boîtes noires » poindre « un défi scientifique passionnant ». En effet, la nouvelle génération de "machines apprenantes" se révèle capable de prouesses inescomptées. Et si, eu égard aux modes dapprentissage grâce auxquels la machine est entraînée à apprendre, il fallait comprendre que ce résultat signale tout bonnement quil y a « des régularités dans nos expressions » que nous ne soupçonnons pas (et dont les data données à la machine pour « muscler » ses capacités statistiques tirent parti) mais qu'elle révèle ? Elles seraient « plus grandes que ce que lon imagine», bel et bien « captées» par ces machines. C'est ainsi qu'« elles nous enseignent sur nous-mêmes, êtres humains... ». Avec lIA la plus avancée, « nous sommes face à un savoir pragmatique en quête de théorie » et cest une situation inattendue, aux antipodes de la théorie de Shannon précise-t-il. Si Shannon a théorisé l'information, ouvrant la voie à des applications, aujourd'hui, c'est l'inverse : des applications existent et elles souffrent de théorie pouvant expliquer ce qu'elles arrivent à produire.
"Simple outil" ?
Nouvelle injonction, lexplicabilité en ce domaine passerait par le truchement suivant : « connais-toi toi même », γνῶθι σεαυτόν en grec. Le précepte gravé au fronton du Temple de Delphes, attribué à Socrate par Platon dans ses propres écrits serait donc de mise pour résoudre une énigme moderne -pardon : pour relever le défi scientifique à la clé de lIA « générative » -, dont le décor fait il est vrai penser au « Mythe de la caverne », une allégorie diversement interprétée de Platon justement.
Seulement voilà, les outils de cet acabit sont « partout », -cash flows déja "sonnant et trébuchant" ou fantasmés, à lavenant-, mais ne sont pas -loin de là- quà usage de « développement personnel », ni réservés à des fins philanthropiques. Bien au contraire Difficile, dans ces conditions, de les dédouaner de facto des impacts éthiques que leur utilisation, dans les divers environnements où ils prospèrent -parfois « à notre insu, de notre plein gré »- provoquent dans nos vies.
Sans ambages, Anne Alombert et Gaël Giraud alertent sur "les logiques sous-jacentes de l'IA, loin de l'objectivité scientifique ou de la neutralité politique" dans Le Capital que je ne suis pas ! Mettre l'économie et le numérique au service de l'avenir (éd. Fayard, 2024).
Force est de constater, à lheure où pourtant la « finance à impact » tend à devenir le mantra nec plus ultra de linvestissement responsable, que ces impacts-là précisément semblent plutôt poussés du pied sous le tapis : combien dentreprises, dans le cadre de leur RSE révèlent et prouvent quelles prennent la mesure et anticipent les questions éthiques spécifiques, en ce domaine ? En matière de gestion financière, quels professionnels osent « interroger » à cette aune leurs pratiques, décrire leurs outils quotidiens bardés d « IA » (dont ils sont aussi familiers que friands, fintech oblige !), et lesquels ont-ils à coeur de répondre de leurs interrogations/précautions auprès de leurs clients investisseurs (autrement que pour se vanter dêtre à la pointe du progrès, car la tendance la plus courante est de semparer des innovations avec gourmandise ) ? Les enjeux sont pourtant bien du ressort de la gestion des risques autant que de la transparence due au client (épargnant/actionnaire) exigées, de plus en plus.
"Combien dentreprises, férues de RSE prennent-elles la mesure
des questions éthiques associées à l'« IA »
et en gestion financière, quels professionnels osent « interroger »
à cette aune leurs pratiques, leurs modèles et leurs outils quotidiens bardés d « IA » ?
D'où, le 30 avril dernier, une soirée-débat autour d'intervenants tels que Christian Walter, pour lequel les techniques de la gestion financière et leurs outils ne sont pas neutres. Par conséquent, les valeurs éthiques arborées par les produits, que linvestisseur responsable croit financer sont-elles dévoyées ou non, du fait de ces passagers clandestins ? Des modèles, des techniques familières en gestion financière sont à interroger dans cette perspective, voire à bannir a-t-il esquissé, et, à l'heure où de manière accélérée, sans ces réflexions préalables par "la force des choses" cette industrie se met à la page, avec des IA à foison, ce point mérite attention....
Le champ des questions que des entreprises férues de RSE (responsabilité sociale et environnementale) à propos dIA peuvent et/ou devraient se poser a été lucidement balayé, exemples concrets à lappui, par Stéphanie Scouppe. Combien se sont attelées, comme elle au sein de son entreprise (ADP) par exemple, à une cartographie des risques en ce domaine, notamment?
Enfin, Arthur Grimonpont, jeune ingénieur qui, aux côtés de Reporters sans frontières (RSF) a uvré à la charte sur lIA et le journalisme publiée il y a quelques mois, a choisi, explicitement, de passer sous silence les avantages de l'IA parce que "ceux qui en tirent profit sont suffisamment prolixes". Son objectif assumé, au risque de faire figure de prophète de l'apocalypse : « Protéger linformation à lère de lIA». Il sest attaché à dépeindre lors de cette soirée-débat le rôle des réseaux sociaux dans notre accès effectif aux sources dinformation et les incidences de leurs algortihmes sur nos capacités de discernement, avec des points de vigilance qui corroborent les alertes de certains neuro-biologistes, notamment.
Linformation, matière première de lintelligence économique et dans une mesure croissante, "nerf" de la finance de marché, est déterminante. Elle est même cruciale, dans la prise de décision. Humaine, de préférence ! Doù limportance de ce sujet à nos yeux. Promis, la teneur de ces interventions et le débat de qualité qui sen est suivi donneront lieu à un compte-rendu, à l'occasion de notre prochaine Newsletter, mi-2024.
Dici là, pour aller plus loin, approfondir un ou plusieurs points, joignez-vous à nous : info@ethinvest.asso.fr
Michèle Royer,
chargée de mission

A quoi, à qui se fier pour "investir éthique" : une soirée-débat d'E&I
Difficile de savoir à qui nous pouvons faire confiance quand nous avons des investissements à faire. Comment être sûr que les ambitions ESG, éthique, écologique des fonds soient réelles ?
Société à mission, label ISR, taxonomie, PRI : y voir plus clair !
Cest en cela que le colloque de novembre fut intéressant, il ma aidé à y voir plus clair dans ce que doit être une entreprise à mission, comment fonctionne un label ou encore ce quest la taxonomie, des termes qui parfois peuvent nous dérouter parce quon ne sait pas très bien ce quil y a derrière.
Jai surtout apprécié lintervention du président de la CAMIF, Emery Jacquillat, qui a su nous partager dune manière simple et concrète ce quest (ou devrait être) une société à mission, et comment, avec ses salariés, ils ont réussi à mettre par écrit la raison dêtre de la CAMIF et à se fixer des objectifs, allant jusquà renoncer à un certain profit. Par exemple, une perte de chiffre daffaire significative attendue, en décidant de fermer le site de vente de ses produits le jour du « Black friday », un acte provoquant, qui a tout dabord suscité une certaine incrédulité car cest un jour faste, pour les commerçants. Y renoncer, quelle folie ? Mais cette décision avait un objectif : aligner manifestement les valeurs prônées par lentreprise, à savoir la sobriété (et donc la non incitation au gaspillage de ressources induit par la « sur-consommation ») avec ses pratiques, pour réveiller les consciences.
Il est bon dentendre rappeler quune entreprise a un rôle et un impact dans la société et quelle nexiste pas seulement pour que des actionnaires se partagent les profits. Jai été surprise par le peu dentreprises qui ont fait ce travail délaboration de leur raison dêtre pour afficher leur modèle économique, au service de lHomme et de la planète. Celles qui le font méritent quon les encourage, à mon avis, pour autant quelles en fassent état et que leurs allégations soient contrôlées. En tant que religieuse, jestime important que notre argent soutienne et favorise la vie et le respect des personnes, comme les entreprises à mission le font, en principe, envers leurs salariés et la planète.
Le label ISR participe aussi en partie de cette confiance et dans ce but son cahier des charges a été révisé, comme la détaillé une autre intervenante du colloque, Michèle Pappallardo, qui a présidé à cette évolution. Avant tout, je retiens que cest un label généraliste à ne pas confondre avec un label vert.
Jai aussi un peu mieux compris ce quétait la taxonomie européenne : un outil pour permettre aux entreprises de valoriser leurs activités durables sur le plan environnemental et donc leur contribution à la transition écologique. Mais les échéances et lengouement relatif pour lutiliser repoussent cette ambition dans un horizon de temps bien lointain Cet outil a le soutien des PRI, qui regroupe des investisseurs signataires de principes pour que la finance favorise un monde soutenable, présent à cette tribune également.
Evelyne Royer, Administratrice dE&I, Économe générale de la congrégation des Sacrés Curs de Jésus et de Marie et de l'Adoration
avec Michèle Royer, chargée de mission E&I

SFDR, CSDD, CSRD : derrière ces sigles, de nouvelles règles en vue... dune économie durable et responsable

Que de sigles jetés en pâtures à linvestisseur regardant, au-delà des ratios classiques ! Gestion de fonds, gestion dentreprise : lenjeu de la communication dinformation en matière de durabilité, sur ces deux fronts, fait évoluer la donne règlementaire, dans lUE. Un point dactualité pour voir un peu plus clair dans ce foisonnement ?
CSDD ou Devoir de vigilance au plan européen
en approche !
Dix ans quasi jour pour jour après leffondrement au Bengladesh du Rana Plaza - immeuble abritant plusieurs ateliers de confection de marques internationales - la commission des affaires juridiques de lUE a approuvé de nouvelles règles visant à intégrer les droits humains et limpact environnemental dans la gouvernance des entreprises, dans une perspective élargie rappelait Murielle Hermellin administratrice dE&I dans la newsletter Flash info ISR de Promepar AM (N°70, mai 2023).
Selon cette même source, si le projet de directive en cours, actuellement sous le sigle CSDD, aboutit les entreprises de lUE ciblées seront tenues didentifier, prévenir, mettre fin ou atténuer limpact négatif de leurs activités, y compris celles de leurs partenaires commerciaux, affectant les droits humains et lenvironnement.
Dans cette perspective juridique, lensemble de la chaîne de valeur est à considérer : les « donneurs dordre » et leurs « exécutants » sont liés également à laune des incidences de leur activité qui se révèleraient délétères pour la Terre et/ou les Hommes. Si le processus législatif européen enclenché se poursuit sur cette lancée, elles seront tenues dévaluer à cette aune leurs partenaires, non seulement les fournisseurs, mais aussi les activités liées à la vente, à la distribution et au transport stipule Promepar AM dans la publication citée supra. Sont notamment visés : le travail des enfants, lesclavage, le « travail forcé » mais aussi la pollution, la dégradation de lenvironnement (climat, biodiversité, notamment).
Après le feu vert de la commission juridique de lUE le mois dernier, le rapport préconisant de se doter dune telle directive a été adopté par les eurodéputés, en ce début juin. Reste à venir le vote du texte de la directive elle-même au Parlement européen ; puis obtenir gain de cause en Conseil in fine.
Concrètement, la CSDD introduirait dans le droit européen la notion de « devoir de vigilance », qui a été pour la première fois proposée par le législateur français dans la LOI n° 2017-399. « Loi Potier » du nom du député qui l'a défendue contre vents et marées.
«Daprès cette loi, dite "Loi Potier", les entreprises ont la responsabilité légale dêtre « vigilantes » en effectuant des évaluations qui identifient les risques de durabilité, ou les risques liés aux abus en matière de droits humains sur lensemble de leur chaîne dapprovisionnement (y compris leurs fournisseurs et partenaires commerciaux); à elles aussi de prendre les mesures pour prévenir ces risques et ces abus, de publier des informations sur les risques de durabilité identifiés et les mesures prises pour y remédier, en leur sein et au sein de leurs prestataires et fournisseurs. La directive européenne de la CSDD projetée reprend dans les grandes lignes les principes du devoir de vigilance, une notion pour la première fois proposée par le législateur français dans la LOI n° 2017-399 ». Cette vigilance au-delà des seuls murs de lentreprise fait partie de sa responsabilité légale daprès cette loi française novatrice, qui fera école au plan européen ?
« Voté par le Parlement européen le 1er juin 2023, le texte devrait être formellement adopté en 2024 » pronostique un cabinet d'experts.
SFDR, double matérialité et typologie des fonds (6 ? 8 ? 9 ?)
Appliquée cette fois aux gestionnaires des produits financiers qui intéressent un nombre accru dinvestisseurs férus dESG (Environnement, Social/sociétal, Gouvernance), lexigence de communication et de preuve, à travers leur reporting, est encadrée par le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure) qui vient dentrer en application ; il adopte une approche dite de « double matérialité », analyse Promepar AM dans un supplément interne daté de mai 2022 : « Dune part, il impose aux acteurs des marchés financiers de fournir des informations sur la prise en compte des « risques en matière de durabilité ». Ces risques correspondent à des évènements ou situations liés aux facteurs de durabilité qui pourraient avoir une incidence négative sur la valeur des Investissements.Dautre part, le règlement SFDR crée des exigences de transparence sur les « incidences négatives en matière de durabilité » ou PAI Principal Adverse Impacts en anglais. Contrairement aux risques de durabilité, il sagit de fournir des informations quant aux conséquences négatives des investissements sur les facteurs de durabilité. Les gérants de fonds de fonds peuvent quant à eux sappuyer soit sur la nature SFDR de chaque fonds, soit (...) sur le processus de sélection ESG» mis en oeuvre, estime cette même source.
Elle se réfère à une définition AMF (Autorité française des marchés financiers) à propos de la typologie des fonds induite par le réglement européen "SFDR":
* Les produits dits « Article 8 » promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales à condition que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés suivent des pratiques de bonne gouvernance.
* Les produits dits « Article 9 » ont pour objectif linvestissement durable, au sens de la taxonomie européenne (qui classe les activités comme étant durables ou pas).
* Enfin les produits dits « Article 6 » ne font pas la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales, qui nont pas un objectif dinvestissement durable et qui ne répondent pas à la définition des articles 8 et 9.
Le reporting des acteurs de l'industrie financière visés par SFDR est en quelque sorte le "pendant" de l'obligation de reporting qui s'impose de plus en plus aux entreprises (les "émetteurs" d'actions et/ou d'obligations parfois) à travers une autre directive en cours d'application, désignée par un autre nouveau sigle : CSRD !
Pour toute question, et tenir à jour vos connaissances sur ces sujets, rejoignez E&I, suivez-nous sur ce site et nos réseaux sociaux :
LinkedIn : Ethique et Investissement
Twitter : @EthiqueInvest
Michèle Royer,
chargée de mission d'E&I
avec Murielle Hermellin, Administratrice d'E&I

Vers une finance plus humaine : 40 ans d'engagement d'E&I. Et tant à faire encore

Pour éclairer le chemin parcouru ces 40 dernières années et celui qui reste à parcourir, afin que la finance favorise une économie plus humaine, Éthique et Investissement a réuni le 19 avril dernier au Forum 104 (à Paris) et en viso, des compagnons de route, témoins et visionnaires. Merci à ces intervenants et aux participants, plus largement, qui ont répondu... "présents" pour se ressourcer et réfléchir à notre avenir commun !
Ce colloque, organisé dans le cadre des évènements anniversaire dÉthique et Investissement, avait pour objectif de revenir sur nos 40 ans de cheminement associatif, tout en réfléchissant sur le chemin à parcourir.
Les intervenants nous ont incité à nous interroger encore et encore sur la signification du mot Éthique. En tant qu'investisseur, nous sommes souvent confrontés à des interlocuteurs (banquiers, assureurs, conseillers financiers, gestionnaires de fonds...) qui mettent en avant les chiffres, le rendement. Croiser cela avec la notion d'Éthique nest pas chose aisée. Le discernement éthique au moment d'investir, d'épargner, requiert du temps et des efforts.
Ethique, vous avez dit "éthique" ?
Nous avons tous, nous personnes lambdas, déjà été en contact avec des "sachants" qui ont, en vain bien souvent, tenter de nous expliquer ce quétait léthique, lISR ; ou encore, les niveaux de risques financiers liés à notre volonté d investir selon nos valeurs éthiques, entre autres arguments, ils nous parlent de réglementations, et emploient un langage bien souvent trop technique, presque inaudible.
Aucun de ces sachants na la science infuse, aucun ne peut donner une indication ferme et définitive de ce qu'il faut faire. C'est là l'objet de la réflexion à mener. Telle est la réalité.
Aussi, notre association sest donnée pour objectif de mettre en relation des professionnels, des particuliers et des religieux, afin que nous puissions réfléchir collectivement aux différentes questions inhérentes à ces sujets sensibles. Notre intention n'étant pas de dicter la "bonne" décision à prendre, dans nos choix quotidiens dans nos missions respectives : cet acte reste de la responsabilité de chacun, in fine.
Mais avant d'arriver à ce moment "décisif", échanger sur le fond, de manière désintéressée, en se mettant à l'écoute de points de vue et d'approches différentes et complémentaires, est indispensable.
C'est ensemble que nous nous posons les bonnes questions, ensemble aussi que nous mûrissons nos réflexions.
Christiane Vanvincq,
Econome Générale Xavières - CA E&I

E&I a maintenant 40 Ans !
1983-2023 : chemin parcouru. Et à parcourir.
Ethique et Investissement, association fondée en 1983 par Nicole Reille, célèbre en 2023 ses 40 ans.
Ce sera l'occasion de rendre un bel hommage à notre fondatrice, Sur Nicole Reille, mais également l'occasion de donner un nouvel élan à l'association, tout en gardant les bases solides qui ont assuré sa vitalité durant ces quatre décennies.
Le lancement de cet anniversaire se tiendra le 19 avril 2023, sous la forme d'un colloque spécial qui aura lieu en fin de journée, à Paris et en visio. Le thème : chemin parcouru
et à parcourir.
Compagnons de route historiques, actuels et à venir : à vos agendas !
Parmi les temps forts destinés à « marquer » ces 40 ans, il y aura un appel à contributions pour réaliser une BD sur la vie de Nicole Reille, pionnière de lISR en France ; un documentaire TV grand public sur les intuitions du groupe déconomes à lorigine dE&I, quant au rôle économique et social/sociétal de linvestisseur ; une thèse en partenariat avec un acteur académique, voire une entreprise éligible au dispositif « CIFRE »
Inscription indispensable ici
Pour en savoir plus :
michele.royer@ethinvest.asso.fr
@EthiqueInvest

Lettre ouverte au Président de la République Française : quid de la voix des épargnants ?
Face au risque de "capture des régulateurs" les co-signataires de cette Lettre Ouverte au Président de la République à propos du fonctionnement de l'AMF l'interpellent.
| LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
|
Copie : au Ministre des Finances au Président du Sénat à la Présidente de l Assemblée Nationale au Président du CESE au Président de lANC au DG du Trésor |
|
Monsieur le Président de la République,
L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est définie par les textes qui la régissent comme "autorité publique indépendante" dédiée à la protection de l'épargne, à la surveillance de l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Si l'AMF dispose d'une certaine indépendance de moyens, avec l'irrévocabilité de son président (non-rééligible) et des membres de ses Collèges, la désignation de toutes ces personnalités se révèle mal refléter cette volonté : le compte ny est pas !
Il devient critique que, quasiment jamais, la voix des épargnants ou des gérants d'actifs ne se fasse entendre, que jamais un contentieux ne puisse mettre en lumière les abus toujours possibles d'un grand émetteur (public ou privé) qu'il s'agisse d'information financière, de produits ou de transactions contestables. Or, la loi dans son Article L 421-1 définit un marché réglementé comme "un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers". Force est de constater, dans les faits, que la diversité nécessaire en loccurrence nest pas effective ; et en particulier, que les intérêts légitimes des épargnants se trouvent sous-représentés au sein du Collège et de la Commission des sanctions sous légide de notre AMF.
La professionnalisation de cet organe de régulation souhaitée en 2003 lors de la fusion de la COB et du CMF pour donner naissance à lAMF a généré une sur-représentation des grandes banques et des grandes entreprises. De fait, avec l'adoption entre 1980 et 2000 du régime dit de banque universelle sur notre continent et aux États-Unis, régime conforté en sortie de crise financière, les intérêts côté "émetteurs" et côté "investisseurs" sont confiés aux mêmes établissements avec la garantie implicite des États. Résultat, sous la férule de quelques puissants groupes, les économies d'échelle ont mécaniquement assuré la primauté de la première catégorie, au détriment de la seconde.
Cette situation de déséquilibre se retrouve peu ou prou dans tous les pays, mais elle nous semble récemment aggravée en France : la nomination de la nouvelle présidente de lAMF a conduit à la démission du (seul) représentant de la "société civile des épargnants" dans la gouvernance de lAMF en place, M. Thierry Philipponnat déclarant par voie de presse : "Les conditions ne sont plus aujourdhui réunies pour que lAutorité des Marchés Financiers fonctionne effectivement comme une autorité administrative indépendante. [...] De façon importante, cette question dépasse de loin la gestion des conflits dintérêts tels quils sont définis par la loi : la capture des régulateurs est un phénomène insidieux."
Ce phénomène contrevient à la définition dune Autorité des Marchés Financiers telle que promise et gravée dans la loi en 2003. C'est pourquoi nous* sollicitons de votre part un examen plus impartial, à tout le moins, des nominations pour la composition du Collège de l'AMF et de sa Commission des sanctions. Mais aussi, votre soutien dans notre interpellation pour donner aux « petits » épargnants et investisseurs « minoritaires» voix au chapitre : c'est un pré-requis à toute véritable indépendance de lAutorité de régulation en question.
Prêts à prendre notre part dans la correction des biais constatés, nous* vous remercions Monsieur le Président de la République de votre attention à notre alerte. Avec lassurance de notre respectueuse considération,
Paris, le 11/01/2023 |
| SIGNATAIRES |
|
Geoffroy De Vienne, Président dÉthique & Investissement (E&I)
Frédéric Tiberghien, Président de FAIR
Gilles Pouzin, Président-fondateur de Deontofi
François Faure, Réseau CEP
Hervé Chefdeville, Président de l'Association pour le Patrimoine et l'Actionnariat Individuel (APAI)
Marc Mathieu, Fédération européenne de lactionnariat salarié
Grégoire Cousté, Délégué Général du Forum pour l'investissement responsable (FIR) |

 |
 |
 |
 |
 |
 |

Que la finance serve le bien commun : hommes/femmes de bonne volonté, tous concernés
LAcadémie Pontificale des Sciences Sociales a publié le 29 novembre 2022 Mensuram Bonam" : un appel à l'action adressé aux femmes et aux hommes de bonne volonté pour qu'ils fassent de la finance un moyen au service du bien commun. Il y tant à faire ! Et, conformément aux Textes : c'est à eux, -à nous- de le faire... Pas de "Deus ex machina" à attendre du Ciel. Retroussons nos manches.
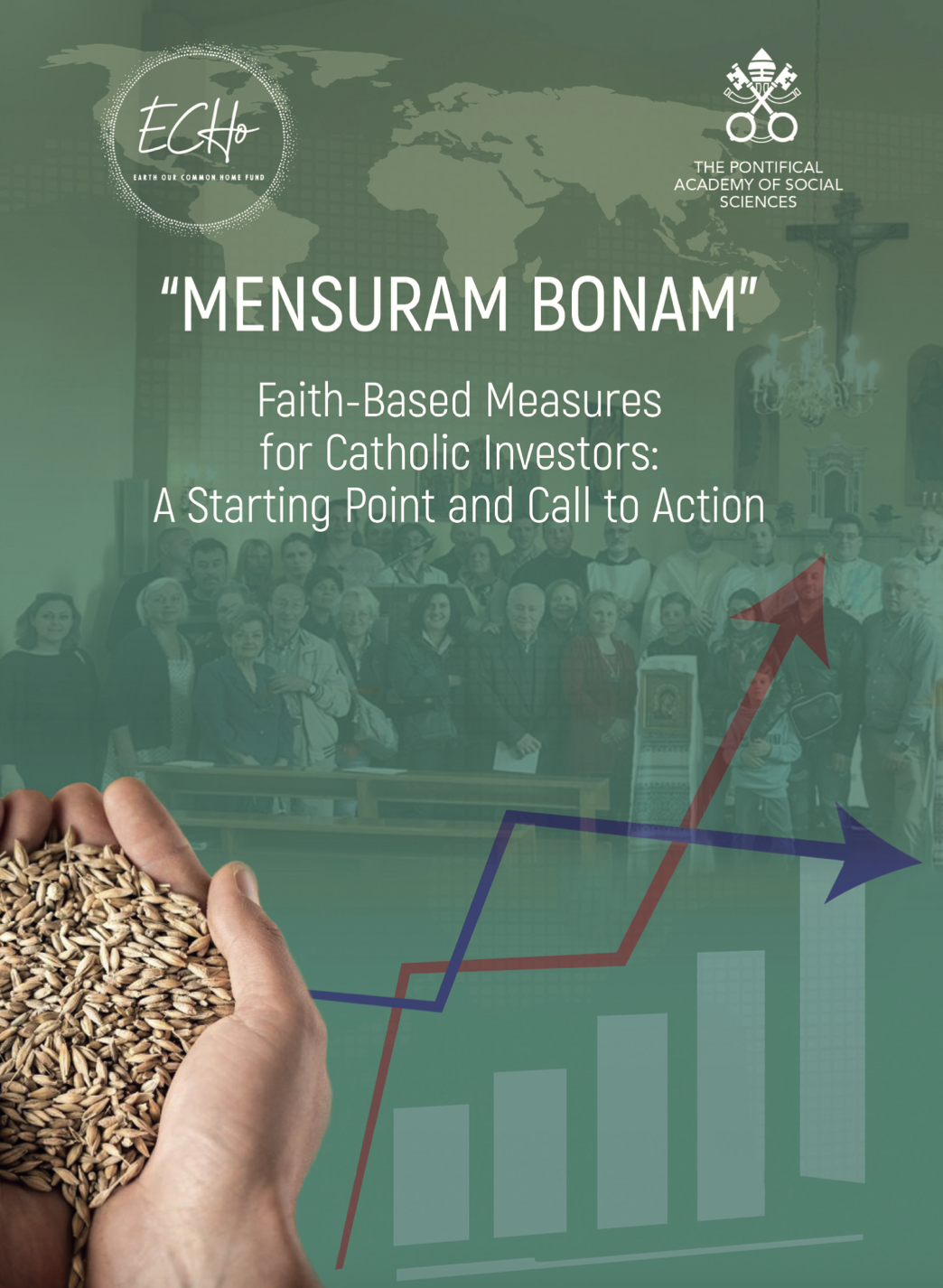 Cet appel, en vue dune finance davantage inspirée par la Pensée Sociale de lÉglise converge avec lélan réformiste que le Pape François a initié et met en place, progressivement (cf notre article du 15 août 2022) avec, notamment, la réorganisation des institutions financières et la nouvelle stratégie dinvestissement du Vatican.
Cet appel, en vue dune finance davantage inspirée par la Pensée Sociale de lÉglise converge avec lélan réformiste que le Pape François a initié et met en place, progressivement (cf notre article du 15 août 2022) avec, notamment, la réorganisation des institutions financières et la nouvelle stratégie dinvestissement du Vatican.
Les travaux de lAcadémie Pontificale publiés dans Mensuram Bonam font tout dabord référence à lambition de la deuxième session du Concile Vatican II (1962-1965) qui était, à léchelle de la vie terrestre des fidèles de lÉglise, de les encourager à des réflexions sur divers sujets afin que les hommes trouvent par eux-mêmes les solutions techniques à mettre en uvre, sans attendre un Deus ex machina dictant ces solutions...
En loccurrence il sagit dun texte qui se veut éclairant, et non pas contraignant, à propos du rôle que chacun est appelé à jouer, dans léconomie via la finance. Il relève que les Dicastères de la Curie Romaine appellent à une utilisation et à une gestion en accord avec les commandements de La Bible qui servent luvre et les volontés de Dieu : Il est important que la gestion des biens créés, comprenant toutes les formes d'activité financière, en particulier la gestion d'actifs, soit dirigée pour refléter ce don de Dieu à la famille humaine, en servant le bien commun, en respectant la justice et les normes éthiques.
Les auteurs soulignent que lEglise na ni le droit ni le pouvoir de simmiscer dans les politiques publiques ou dans les vies privées des fidèles. En revanche, Elle souhaite poursuivre sa mission qui est celle de la recherche de la vérité, et conformément à lEvangile de Jean au Chapitre 8 verset 32, il ny a que la vérité qui permet de parvenir à la liberté.
Dès lors, la lumière de l'Evangile et de la Doctrine Sociale Catholique que Mensuram Bonam entend apporter sur la gestion des avoirs financiers relève de la mission de vérité de lEglise, qui n'est pas seulement la vérité de la foi, mais aussi la vérité de la raison. Lenseignement social de l'Église est une application particulière de cette rencontre entre la lumière de la foi et la lumière de la raison.
Dans le cadre des activités et des convictions de notre association, cette prise de position de l'Académie vaticane constitue une sorte de consécration de la vision de notre fondatrice Sur Nicole Reille. Ce document confirme également que la mission est loin d'être achevée ; elle est plutôt destinée à prendre de l'ampleur dans lavenir.
Pour les auteurs de Mensuram Bonam qui ont travaillé sous l'égide de l'Académie des Sciences Sociales du Vatican : "Depuis que la finance a pris un rôle éminent à tous les niveaux de l'activité humaine, (...) réfléchir aux exigences de la vie de disciple chrétien, y compris la vocation des personnes à la gestion dans ce domaine, est devenu plus critique. Il est important que la gestion de ces biens, en particulier des actifs -et toutes les formes d'activité financière sont incluses dans ce raisonnement-, soit efficace et orientée pour refléter ce don de Dieu à la famille humaine, en servant le bien commun, en respectant la justice et les normes éthiques" (...)
Quelques "verbatim" (provisoires, car la traduction en français n'est à date pas encore parue) :
« Comme le Pape François l'observe souvent, la crise actuelle due à la pandémie de Covid-19 a mis à jour d'autres pandémies affectant les systèmes sociaux pour les rendre dysfonctionnels, d'où l'insécurité de l'emploi, le faible accès aux soins de santé, l'insécurité alimentaire et la corruption. (...) Chaque fois que cela est nécessaire, nous sommes appelés à soutenir les changements de valeur nécessaires, via les critères d'investissement pour bâtir un avenir post-pandémique meilleur, dans lequel nous voulons investir».
« Les paroles du pape Benoît XVI à propos de la crise financière de 2008 restent d'actualité : "La crise actuelle nous oblige à replanifier notre parcours à nous fixer de nouvelles règles et à découvrir de nouvelles formes d'engagement, à nous appuyer sur les expériences positives et à rejeter les expériences négatives. La crise devient ainsi une occasion de discernement, dans laquelle nous pouvons façonner une nouvelle vision de l'avenir". Dans cet esprit, avec confiance plutôt qu'avec résignation, il convient d'aborder les difficultés du temps présent »[Caritas in veritate, 21].
L'un de ces participants au groupe de travail signataire de cette publication, Pierre De Lauzun observe dans l'un de ses derniers livres, Finance A Christian Perspective From the Medieval Bank to Financial Globalization (2021) : " Dans le Nouveau Testament, il y a une pensée et un raisonnement économiques" trop rarement pris en considération.
Pierre de Lauzun, l'un des membres du groupe de travail à l'origine de Mensuram Bonam l'évoque précisément dans l'entretien qu'il a accordé à Ethique et Investissement, représenté par Pierre-Henry Leroy, membre du CA. Un échange nourri, sur plusieurs sujets tantôt historiques, tantôt d'actualité, à visionner ici.
Michèle Royer
avec Viviane Kao

Investir dans larmement revient-il à financer la guerre ou la paix ?
Ce titre est une interpellation des investisseurs, centrée sur leur part de responsabilité dans la portée des activités des industries darmement.
Pour alimenter nos réflexions sur les armes létales, dont le financement serait en crise nous avons voulu interpeller aussi lIndustrie elle même, lArmée et les politiques qui ont aussi leur part de responsabilité, avec chacun leurs propres contraintes à gérer. Un maître-mot pour guide : comprendre les différents points de vue constitutifs de la problématique.
Lexclusion -ou non- du secteur de larmement de nos portefeuilles est lun des sujets graves du moment
Dune part le contexte normatif prônant la « durablité » invite à lexclusion (taxonomie discutée au sein de l'UE, écolabel européen....); dautre part, la guerre qui fait rage sur le continent européen exacerbe, au contraire, le souhait davoir une Défense capable dassurer la sécurité nationale.
Rien détonnant donc à ce que la question tance investisseurs et épargnants consciencieux : Investir dans larmement revient-il à financer la guerre ou la paix?*
Doù le choix de ce thème pour notre colloque du 16 novembre dernier. Les intervenants et les questions de la salle ont permis daffiner la perception de ce secteur sujet à caution, la qualité de son fonctionnement eu égard aux valeurs qui nous animent, et finalement de cerner un peu mieux son rôle et la place particulière quil occupe dans lorganisation de la société et des missions de lEtat. A la tribune, quatre intervenants représentatifs ont apporté des éclairages complémentaires :
1 Un ingénieur de lindustrie de larmement
Pierre-André Moreau, reconnu comme le « père » dune arme que lon (re-)découvre aujourdhui, car elle sert à la Défense de lUkraine dans la guerre qui loppose à la Russie, nous a fait entrevoir quelles difficultés soulèvent le financement dune arme innovante - le canon Caesar- en loccurrence. Ces difficultés ne datent pas d'aujourd'hui ! A lépoque de GIAT industrie (Nexter aujourdhui) où ce Général de la DGA fut « détaché » dans les années marquées par la chute du Mur de Berlin, financer une telle invention (pour des tirs d'artillerie plus ciblés, plus "furtifs", potentiellement moins meurtriers) relevait déjà de la gageure : contre lavis des Etats Majors, le ministre de la Défense dalors décida d'autorité d« amorcer la pompe » ; ensuite, les commandes de pays tiers, parmi lesquels l'Arabie Saoudite, ont permis de continuer à faire tourner quelques chaînes de production à Bourges, berceau de canon Caesar.
En matière darme, fruit de techniques duales, de plus en plus -cest-à-dire composée déléments utiles aux plans à la fois civil et militaire-, chères et longues à produire, les débouchés à lexport sont clés. La France est à lheure actuelle encore lun des trois plus grands exportateurs darmes au monde.
2- Un représentant du dialogue industriel-investisseurs, à lère de lISR
Pour un industriel, même si son métier est de fabriquer/vendre des armes, il y a de nombreuses façons de lexercer de façon responsable, tant au niveau des caractéristiques des armes à fabriquer quil lui revient en dernier ressort de définir, quà laune des demandes des clients quil peut accompagner (ou pas : cf les armes prohibées par les traités internationaux, telles les mines anti-personnelles notamment, ou susceptibles dentacher sa réputation, comme on le voit avec les « robots tueurs ») ; et aussi, dans sa façon de les fabriquer et de les vendre, par son attitude et par ses choix, lindustriel exerce sa responsabilité sociale et environnementale (RSE). Ces choix ont un impact sur les conséquences humaines des conflits présents ou futurs.
Sur la RSE mise en place -notamment contre le risque de corruption- et à propos du risque dexclusion sectorielle a priori -problématique pour une entreprise cotée-, Bertrand Delcaire, directeur des relations avec les investisseurs chez Thalès, a témoigné des actions de conformité à lactif de son groupe. De la salle virtuelle, une question est venue pointer le caractère arbitraire des prohibitifs « 5% du CA tiré des armes » : dans l'analyse extra-financière, ce ratio, sans fondement scientifique connu, lorsqu'il est atteint fait basculer lentreprise dans la catégorie des entreprises frappée danathème (notamment, dans certaines pays de lUE ayant adopté un cahier des charges pour leur écolabel drastique envers ces activités). Un critère suffisant ?
3 A linterface des besoins des Etats-Majors et des fabricants darmes, un ancien conseiller du Ministre de la Défense, ingénieur, militaire (DGA)
Les militaires ont pour fonction de défendre la Nation. Ils sont soumis au contrôle des politiques mais ils ont aussi des choix à faire, des choix stratégiques et tactiques, conditionnés dabord par la perception de la menace et ensuite par les modalités de réponse à ces menaces, notamment par lacquisition darmements.
Les choix formulés dans leur dialogue avec lindustrie de larmement sur les caractéristiques des armes lors des appels d'offre auront un impact sur les conséquences humaines des conflits présents ou futurs.
Jacques Bongrand, qui fut notamment, en charge des programmes et budgets à la DGA où il a fait lessentiel de sa carrière, a partagé son retour dexpérience au carrefour des besoins des Etats Majors et des appels doffres destinés aux industriels. De l'intérieur, il a éclairé comment les politiques et leur bras armé que sont les gouvernements, non pas dans leur rôle de prévention/gestion des conflits mais dans leur rôle de régulateur des industries darmement, tant au plan national quau plan international ont également une responsabilité dans la question de la portée des activités des industries darmement.
Auteur dun recueil de réflexions collectives sur les Aspects éthiques et sociaux des nouvelles techniques de défense en 2015, il a en outre campé les grandes évolutions et les défis éthiques qui caractérisent ces dernières années.
4 A la jonction des analystes extra-financiers et des gérants de fonds ESG
Lindustrie de larmement est financée par des fonds publiques sous le contrôle des politiques et des fonds privés sous le contrôle des investisseurs. Les choix des investisseurs lorsquils décident de sintéresser à ce secteur sont conditionnés par la qualité des analyses extra financières qui leur serviront de guide. Les choix faits par les analystes extra financiers, tant dans les méthodes danalyses que dans la communication de leurs résultats, ont ainsi une influence sur les décisions de linvestisseur.
Directeur associé du cabinet Sustainalytics qui évalue les entreprises à laune de leur RSE, aux avant-postes des évolutions règlementaires et sociétales qui impactent lISR, Axel Pierron a dressé un panorama du secteur et de la situation concernant lanathème auquel il est notoirement exposé. A noter : lexclusion a priori, massive, de certains secteurs par les investisseurs qui se réclament de lISR nest pas sans lien avec leur performance boursière. Il se trouve que les valeurs de larmement nétaient pas particulièrement séduisantes, avant que néclate la guerre entre lUkraine et la Russie ; depuis, les cours de société comme Thalès ou Dassault se sont envolés. Une raison suffisante pour désinvestir/investir ?
Dans cette chaîne de responsabilité, il y a le particulier qui peut agir en tant quinvestisseur sur lindustriel (investir, désinvestir, engagement/plaidoyer, .... ) et en tant que citoyen sur le politique avec son bulletin de vote. Les quatre interventions ont suscité des échanges nourris avec les participants présents dans la salle des Nymphéas du Forum 104 à Paris, et ceux de la salle virtuelle. Sans épuiser le débat, naturellement !
chargée de mission E&I
*NB: pour accéder à des ressources documentaires complètes, cliquer sur les mots soulignés :
Programme du colloque ici

Investir éthique : nouvelle feuille de route apostolique romaine !
A compter du 1er septembre prochain, dans un nouveau cadre organisationnel, une politique d'investissement "alignée" avec ses valeurs va être expérimentée pour les fonds du Vatican. En primeur, quelques informations, à date, sur les critères préconisés et les instances réformées selon le vu du pape François dont lEncyclique Laudato Si séduit des générations, au-delà des cercles « catho »...
Viser une « contribution à un monde plus juste et soutenable ». Voilà un objectif cohérent avec lEncyclique Laudato Si. Il figure en bonne place, parmi les objectifs assignés à toute future décision d'investissement, pour le compte du Vatican, dans un document émanant du Secrétariat pour l'Economie (SPE) placé sous l'autorité directe du Pape François, selon la nouvelle Constitution publiée cette année aussi.
Plus avant, dans le même document qua pu consulter E&I, apparaît un autre objectif primordial : investir de préférence dans des activités productives (favorisant l'"économie réelle") plutôt que spéculatives. Echo à un autre document, publié le 17 mai 2018, Oeconomicae et pecuniariae questiones : y est stigmatisée, en effet,« une mauvaise financiarisation de léconomie » qui fait « en sorte que la richesse virtuelle, principalement concentrée sur des transactions caractérisées par une intention de pure spéculation et sur des transactions à haute fréquence (high frequency trading) attire à elle des capitaux en trop grand nombre, les soustrayant ainsi aux circuits vertueux de léconomie réelle ». Lintention nest pas anti-financière, mais de remettre la finance à sa place : un instrument au service de la Création. Et non linverse. Dans cette perspective, bien sûr, rendement (utile) et sécurité de la mise sont de rigueur. Mais pas seulement.
Exclusions éthiques : retour aux origines religieuses de lISR
Historiquement, en matière de finance éthique rappelle Patrick Jolivet dans lEncyclopediae Universalis, « Il s'agissait de placer les fonds de communautés religieuses conformément à leurs principes, en excluant les « actions du péché » (sin stocks) : actions des entreprises d'armement, des producteurs d'alcool, de pornographie, etc. Si cette pratique d'exclusion de certains portefeuilles d'actifs financiers existe encore actuellement, notamment dans les pays nordiques et anglo-saxons, la finance dite responsable ou éthique s'est développée dans des pays comme la France sous l'impulsion des préoccupations liées au développement durable et à la responsabilité sociale de lentreprise » en misant aussi sur la capacité à faire « évoluer » les valeurs investies, de lintérieur.
A date, dans le document accompagnant linstallation du nouveau Comité dInvestissement du Vatican, lexclusion de certains secteurs et de certains véhicules nest pas taboue. Ainsi, au rang des produits, technologies et secteurs à bannir figurent, au bas mot : la pornographie, la prostitution, le jeu ; mais aussi, larmement, lavortement ; et dans la même veine, les entreprises pharmaceutiques impliquées dans la production de contraceptifs et la manipulation dembryons. Au nom du respect absolu de la vie.
Sont aussi listées des pratiques, pas vraiment exclues, mais dites « à éviter » : les investissements spéculatifs portant sur les « commodités » (matières premières minières , agricoles et énergétiques ) et dans lindustrie de lénergie nucléaire, ainsi que dans les compagnies productrices de boissons alcoolisées.
De surcroît, il appartiendra au comité dinvestissement institué dans le cadre de la nouvelle organisation administrative du Saint-Siège détendre éventuellement cette liste ; et aussi, détablir la liste des pays trop peu regardants sur la corruption, le blanchiment A proscrire de son univers dinvestissement. Du moins, cet organe consultatif aura-t-il, sur cette question, voix au chapitre.
E,S,G : des facteurs en odeur de sainteté
A contrario, les facteurs E,S,G prisés par les assets managers « engagés » méritent considération ! Avec cet avertissement en prime : il est nécessaire que le Comité planche sur une méthodologie destinée à vérifier lalignement des « Best-in-class » (en tout cas, identifiés comme tels par les analystes) avec lenseignement social de lEglise, et à mesurer limpact positif, démontrable, des investissements préconisés à l'aune de léquité et de la lutte contre le dérèglement du climat.
Les statuts de ce nouveau comité dinvestissement stipulent, dès larticle premier, que la sélection et leffectivité des choix doivent être conformes « à lenseignement social de lEglise catholique et aux principes ESG », ces derniers étant chers à lISR et, dans une certaine mesure aussi, à la taxonomie européenne.
En revanche, pas un mot sur lactivisme ni le dialogue actionnarial dans la définition de la politique dinvestissement confiée par le Secrétariat de lEconomie au comité dinvestissement du Vatican !
Soulignons toutefois quau premier rang des principes est réaffirmé que « toute décision dinvestir dans tel placement plutôt que tel autre, de préférer un secteur dactivités à un autre est toujours un choix moral et culturel ». Autrement dit, une responsabilité à exercer en son âme et conscience, de manière éclairée, comme Ethique & Investissement ne manque d'ailleurs jamais de le préciser dans ses Ateliers, formations et prises de positions depuis près de 40 ans. Autrement dit, pas comme un automate, ni un individu sen remettant aveuglément à dautres, y compris à de lintelligence artificielle !
La clé : organisation et compétences à la hauteur de l'enjeu
Au journaliste Phil Pullela qui a demandé au Souverain Pontife «Pensez-vous qu'il y a eu suffisamment de changements pour éviter que des scandales ( ) ne se reproduisent ?». «Je crois que oui», a répondu le Saint-Père, avec «la création du Secrétariat pour l'économie avec des personnes techniques, qui comprennent, qui ne tombent pas dans les mains de bienfaiteurs, ou d'amis qui peuvent vous faire déraper; je crois que ce nouveau dicastère, disons, qui a tous les financements entre ses mains, est une vraie sécurité dans l'administration. Parce qu'avant l'administration était très désordonnée». Il a alors cité l'exemple d'un chef de bureau de la secrétairerie d'Etat qui devait gérer les finances mais qui, n'étant pas qualifié, cherchait, en bonne foi, des amis pour lui donner un coup de main, rapporte Reuters auquel le Pape François a accordé une interview publiée le 12/07/2022. «Mais parfois les amis n'étaient pas la bienheureuse Imelda et donc ce qui est arrivé est arrivé» (Imelda, une jeune fille du XIV e siècle qui est un exemple de pureté). Dans les scandales, comme celui lié à lachat dun immeuble à Londres, auquel le journaliste faisait référence, la faute était, a précisé le Pape, "l'irresponsabilité de la structure, à ce moment-là, qui a attribué la responsabilité à une bonne personne qui était là parce qu'elle avait la place qu'elle avait. Et celle-ci ne connaissait pas les choses financières et a dû demander de l'aide à l'extérieur sans contrôles suffisants de l'intérieur. L'administration manquait de maturité». » Daprès larticle de lOsservatore Romano relayant cet entretien, le Pape a conclu en rappelant que «l'idée du Secrétariat pour l'économie est venue du cardinal Pell. Cest lui qui a été le génie ».
Dans 5 ans, le dispositif donnera lieu à un "retour dexpérience". Un "Retex" attendu.

Michèle Royer
chargée de mission E&I

Revivez en intégralité notre dernier colloque : "LA CROISSANCE EN QUESTION"
REVIVEZ LE DERNIER COLLOQUE EN REPLAY SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !
Éthique et Investissement a récemment organisé son premier colloque de l'année 2022.
Afin de revivre ces moments, le visionnage intégral de cet évènement est disponible sur notre page YouTube.
Cliquez sur l'icône pour revoir le débat
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de notre actualité, commentez et partagez.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LUNDI 16 MAI 2022
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LUNDI 16 MAI 2022
DE 15h à 17H
L'association Éthique et Investissement tiendra son assemblée générale annuelle relative à l'année 2021 le lundi 16 mai à L'enclos Rey.
Au programme :
I- Présentation du rapport moral
II- Présentation du rapport financier 2021 et du budget
III- Présentation des résolution soumises au vote
LAssemblée générale est un temps important dans la vie de lassociation, alliant rétrospective de lannée écoulée et présentation des actions stratégiques à venir. Votre mobilisation est essentielle ! Nous espérons vous retrouver nombreux à cette réunion adhérent ou non!
Nous vous rappelons que seuls les adhérents à jour de leur cotisation au 31 décembre 2021 pourrons voter sur les résolutions présentées.
Entre 17h et 18h, une pause rafraîchissante sera offerte aux participants présents sur place.
Cette assemblée générale sera suivie d'un colloque « La croissance en question ». Pour plus d'information, cliquez ici

Nouvel Article Famille Chrétienne
Épargne : Comment investir pour le bien commun ?
Le grand public veut investir son épargne de manière éthique aujourdhui. Mais comment investir pour le bien commun ? Fonds dinvestissement ou projets concrets, de belles opportunités existent. État des lieux.
Investir de manière éthique, une responsabilité morale
Premier constat, investir dans la finance « éthique » est aujourdhui rémunérateur, financièrement mais aussi humainement. Ainsi, au premier trimestre 2020, en pleine crise sanitaire mondiale, alors que le CAC 40 subis- sait une baisse de 17,5 %, les fonds Investissement socialement responsable (ISR) se sont montrés plus résistants, en nenregistrant que 6,5% de perte. Du côté des épargnants, les professionnels de la finance éthique interrogés pour cette enquête constatent une véritable prise de conscience du grand public et une explosion des demandes pour investir de façon éthique dans des projets pérennes et porteurs de sens. Reste à savoir comment investir pour le bien commun, en conformité avec la Doctrine sociale de lÉglise. Pour cela, de plus en plus dacteurs du monde de la finance éthique, dinspiration ou ouvertement catholiques, proposent des conseils, des produits financiers ou des projets concrets pour guider ceux qui veulent investir leur épargne pour le bien de toute la société. En effet, ce nest pas simple de sy retrouver.
Le terme de « finance éthique » est aujourdhui très usité et de nombreux placements sen recommandent souvent avec des terminologies différentes. Par exemple, on parle plus récemment de finance à impact, sorte de « fourre- tout » très généraliste, qui propose dinvestir dans une cause qui offre un rendement...
Découvrez l'article dans son intégralité en cliquant ici

L'AFFAIRE ORPÉA

Revivre notre dernier colloque "pour une écologie verte ou humaine ?"
REVIVEZ LE DERNIER COLLOQUE EN REPLAY SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !
Éthique et Investissement a récemment organisé sa dernière soirée débat afin de clôturer l'année 2021.
Afin de revivre ces moments, le visionnage intégral de cette soirée est disponible sur notre page YouTube.
Cliquez sur l'icône pour revoir le débat
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de notre actualité, commentez et partagez.

Communiqué de presse: Éthique et Investissement interpelle Glencore
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
"Éthique et Investissement interpelle le groupe GLENCORE sur ses activités relatives au charbon et sur les impacts de ses sites sur les populations locales notamment sur une mine à ciel ouvert en Colombie. Sa position de leader dans la filière charbon implique de sa part un comportement social exemplaire."

Revoir le colloque: "La Doctrine Sociale de l'Eglise comme stratégie d'investissement" - 10 mai à 15h30
Éthique et Investissement a organisé un colloque sur le thème:
Doctrine Sociale de l'Eglise comme stratégie d'investissement
Lundi 10 mai de 15h30 à 18h
Pour revoir cette conférence cliquez ici
Nous partons du constat qu'il existe un certain nombre de fonds labellisés "chrétiens" ou "conforme à la Doctrine Social de l'Eglise" mais qu'ils recouvrent des réalités très différentes.
Ce colloque avait pour objectif:
- Découvrir lhétérogénéité des fonds dinvestissement « éthiques » et chrétiens présents sur le marché
- Comprendre les différentes lectures de la Doctrine Sociale de lEglise et des conséquences qui en sont tirées dans les décisions dinvestissement
- Alimenter votre propre réflexion sur les décisions dinvestissements, reposant sur des fondements chrétiens.
- Dialoguer et débattre avec les intervenants de la pertinence et des limites dune approche chrétienne dans une stratégie dinvestissement
Cliquez ici pour plus d'information sur le contenu du colloque et ses intervenants.

Recherche de bénévole(s)
Recherche de bénévole(s)
L'association Ethique et Investissement est à la recherche de bénévoles pour l'aider dans la réalisation de ses missions quotidiennes.
Deux postes sont à pourvoir. Nous recherchons des personnes motivées qui occuperont les missions suivantes :
- Responsable administratif (H/F) : cliquez ici pour en savoir plus
- Chargé de communication (H/F) : cliquez ici pour en savoir plus
Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter laure.peronnin@ethinvest.asso.fr
Nous espérons que vous rejoindrez notre association!
Toute l'équipe d'Ethique et Investissement

Compte rendu atelier éthique: traiter les cas de conscience
Vendredi 25 Octobre s'est déroulé le premier atelier éthique du thème des "cas de conscience". Nous voulions ainsi aborder des cas concrets qui nous mettent devant limpératif de faire des choix. Et il nest pas certain que nous puissions toujours honorer tous nos critères éthiques dans lenvironnement financier complexe que nous connaissons.
Cette première rencontre nous a permis d'aller plus loin sur la question des énergies fossiles. Ci joint vous en trouverez un compte rendu.
La prochaine rencontre se déroulera le vendredi 14 février de 10h à 12h. Nous vous communiquerons ultérieurement le cas de conscience que nous traiterons ainsi que le lieu de la rencontre.
pour plus d'information:
Geoffroy de Vienne - geoffroy.devienne@sfr.fr
Christiane Vanvincq - christiane.vanvincq@xavieres.org

STOP CETA
Comme tout les parlement nationaux des pays de l'Union Européenne, le parlement français est appeler à ratifier le CETA, l'accord commercial UE/Canada, mis en place à titre "provisoire" en septembre 2017.
Avec d'autres, Ethique et Investissement demande aux parlementaires français de ne pas ratifier le CETA en vue de réouvrir des négociations surtout sur les questions sociales, environnementales et d'arbitrage des différents.
"Lexamen du CETA représente bien plus quune simple ratification. Il est en effet le premier, mais aussi le dernier accord de commerce de nouvelle génération, sur lequel vous aurez à vous prononcer dans la mesure où lUE organise désormais ces traités de façon à pouvoir adopter leur volet commercial uniquement à léchelon européen. Si vous le ratifiez en létat, la France se privera d'un puissant levier pour obtenir une réforme de la politique commerciale européenne. Elle pourrait ainsi rester isolée comme au moment de la relance de négociations avec les États-Unis.
Enfin, le CETA sert de modèle pour tous les accords qui suivent (Vietnam, Mercosur, Mexique, Nouvelle Zélande, Australie, etc.)."

Difficile choix que celui de désinvestir des énergies fossiles
Le 3 octobre dernier, 40 nouvelles institutions catholiques ont annoncé le retrait de leurs investissements dans les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) venant ainsi rejoindre le mouvement mondial qui avait commencé en octobre 2015. Il est certain que lexploitation des énergies fossiles, responsable denviron 70% des émissions de gaz à effet de serre, à lorigine du réchauffement climatique, doit être drastiquement restreinte et remplacée par des énergies renouvelables et une transformation générale de notre modèle de société.
La position à adopter quant au financement des entreprises productrices dénergies fossiles est pour autant loin dêtre simple.
Ny a-t-il pas une contradiction à sortir, par conviction, ses actifs du secteur des énergies fossiles tout en continuant inévitablement den être un utilisateur régulier. Personne aujourdhui ne peut vivre dans notre modèle de société sans consommer directement ou indirectement des matières fossiles.
Par ailleurs, le désinvestissement nexerce pas une véritable pression économique sur les entreprises du secteur parce que les montants désinvestis à ce jour ne représenteraient que 2% de la capitalisation du secteur qui naura pas de mal à trouver dautres financeurs. Afin de donner au désinvestissement une portée économique, il faudrait que les fonds désinvestis soient réinvestis dans les énergies renouvelables ce qui semble nêtre le cas quà hauteur de 30%. Pour aller jusquau bout du raisonnement, il faudrait cesser dinvestir dans lensemble des entreprises utilisatrices dénergie ou de produits fossiles (productions de dérivés du pétrole).
Le choix du désinvestissement est donc avant tout un acte politique militant destiné à lancer un signal aux entreprises, aux institutions financières ainsi quaux gouvernements et à lopinion publique. Et cela est utile.
Mais il y a aussi de bonnes raisons de rester investi dans le secteur des énergies fossiles pour en accompagner la nécessaire mutation, comme E&I a choisi de le faire pour le fonds NS50.
En effet, être actionnaire cest avoir un droit de vote et dinterpellation aux AG. Cela a du sens de se regrouper entre actionnaires responsables pour dialoguer et peser sur la conduite dune véritable transition énergétique qui ne consiste pas seulement à céder ses activités polluantes à dautres. Rester actionnaire, cest également éviter que dautres actionnaires, peu concernés par les enjeux écologiques et sociétaux du secteur, ne rachètent les actions cédées avec un objectif de rentabilité à court terme.
La position adoptée par E&I est complémentaire de celle adoptée par les institutions qui ont choisi de désinvestir car il faut sans doute aborder la transition énergétique par plusieurs angles à la fois.
Agathe DAVID, chargée de mission
agathe.david@ethinvest.asso.fr

ETATS GENERAUX DE LALIMENTATION : lespoir dune avancée pour les producteurs et les consommateurs ?
Létape des états généraux de lalimentation qui sest tenue durant la semaine du 10 octobre fait particulièrement écho aux conclusions que nous avions tirées de notre colloque du 14 avril 2016 sur léthique de linvestissement dans lagro-industrie.
En effet, nous avions souligné chez les industriels de lalimentation lémergence positive, mais encore insuffisante, dinitiatives ponctuelles en vue dune production plus responsable sur le plan environnemental et sur le plan social (limitation des produits chimiques, relation économiquement équilibrée avec des producteurs de qualité). Nous avions observé que lextension de ce mouvement reposait aussi sur limplication des pouvoirs publics et ladhésion active des consommateurs quil faut informer et éduquer à lidée daccepter un prix parfois plus cher pour une consommation plus responsable répondant cumulativement aux intérêts propres de chaque partie prenante (revenus suffisant pour les producteurs, alimentation plus saine pour les consommateurs).
Dans le principe, on ne peut donc que se réjouir de ces états généraux dont lobjectif est de remédier durablement à la baisse des revenus des professions agricoles par une répartition plus équitable de la valeur entre les différents acteurs de la chaine (producteurs, transformateurs, intermédiaires divers, distributeurs) tout en favorisant une production alimentaire plus durable, plus saine et financièrement accessible à tous.
Les mesures techniques (reconstruction des prix à partir des coûts de production, contractualisation pluriannuelle, relèvement du seuil de vente à perte ) issues de ces états généraux et dont la mise en place par les pouvoirs publics est souhaitée pour 2018, devraient renforcer les initiatives volontaires existant déjà.
Voilà qui inspire toutefois deux réflexions :
-Comment cela va-t-il sarticuler avec la mise en uvre (à titre provisoire !) du CETA qui va exactement dans le sens inverse ? (cf. ComEcoFi n°7 sept 2017)
-Le comportement du consommateur est déterminant dans le succès des mesures envisagées car ce dernier situé en fin de chaine, échappe à toute réglementation et sest habitué aux prix « discount » des grandes surfaces.
Certes motivé par la perspective dune alimentation de meilleure qualité, il est freiné, dune part, par sa méfiance sur la fiabilité des produits au vu des récents scandales alimentaires et, dautre part, par son pouvoir dachat mis à mal par linévitable augmentation de prix « justifiée » par des modes de production plus responsables.
Cela ravive incidemment le débat sur les excessives disparités de salaires dans cette filière, que nous examinerons lors de notre colloque davril 2018. Cela pose aussi la question des accompagnements fiscaux qui pourrait prendre, par exemple, la forme dun taux de TVA plus bas sur les produits alimentaires responsables.
Parallèlement, comme nous lavions mentionné dans notre colloque du 14 avril 2016, il faut faire adhérer le consommateur aux impacts sociaux et environnementaux de sa consommation. Des organismes préconisent ladoption dun label RSE propre à lagriculture qui serait à la fois environnemental et social.
Agathe DAVID, chargée de mission
agathe.david@ethinvest.asso.fr

Tensions croissantes autour de lentrée en vigueur du CETA en France
La mobilisation anti-CETA en France sest intensifiée depuis que le Conseil Constitutionnel a rejeté, fin juillet, avec une motivation évasive le recours en incompatibilité de ce traité avec la Constitution française.
On le rappelle, le CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) est un accord de libre-échange conclu entre lUnion Européenne (UE) et le Canada et validé le 15 février dernier par le Parlement européen. Il est prévu quil fasse lobjet dune application provisoire à partir du 21 septembre 2017, avant même sa ratification par chacun des parlements nationaux des 28 états membres de lUE, ce qui prendra plusieurs années.
Ce traité, destiné à faire progresser de 25 % le commerce de biens et services entre lUE et le Canada, est contesté par une bonne partie de la classe politique française et des ONG car il va bien plus loin que les traités de libre-échange traditionnels qui consistent simplement à réduire les barrières tarifaires. En effet, cest un accord visant à libérer non seulement les échanges commerciaux mais aussi les investissements.
Le CETA se révèle favorable aux intérêts des multinationales et peu contraignant sur le plan social et environnemental. En outre, il comporte une clause arbitrale qui prévoit que les entreprises et investisseurs canadiens pourront attaquer en dommages-intérêts les États européens devant un tribunal arbitral si des décisions étatiques sont incompatibles avec les dispositions du traité et leur portent préjudice. Concrètement, les états de lUE pourraient ainsi être dissuadés dadopter de nouvelles réglementations nationales de protection de lenvironnement et de la santé des citoyens, par crainte des poursuites et sanctions que prévoit le CETA. Au-delà des enjeux environnementaux et sociaux, se pose la question de la remise en cause de la souveraineté démocratique des états européens.
Une commission dexperts français, chargée, à la demande dEmmanuel Macron, dévaluer le rapport bénéfices/impacts négatifs du CETA, a rendu son rapport les 12 septembre dernier. Il en ressort que la mise en uvre du CETA entrainerait une augmentation des gaz à effet de serre et remet en cause la capacité des états européen à adopter de nouvelles mesures visant à lutter contre le réchauffement climatique et contre lutilisation de produits chimiques nuisibles à la santé des consommateurs.
La FNH (Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et lHomme), lInstitut Veblen et lONG Foodwatch ont vigoureusement rappelé le Président Macron à sa promesse de campagne de demander la renégociation du traité si les conclusions de cette commission se révélaient négatives. Ils exhortent le chef de létat à sopposer à lentrée en vigueur du CETA et à en réclamer la renégociation.
Cependant le 21 septembre dernier, le gouvernement ne sest pas formellement opposé à lentrée en vigueur du traité, à titre provisoire, ce qui engage la France dans un engrenage désormais plus compliqué à renverser.
Reste encore lespoir que le Parlement français ne ratifie pas le traité. Mais nul ne sait quelles en seraient les conséquences concrètes au niveau européen : abandon multilatéral du traité, maintien de lapplication à titre provisoire, application dans les seuls états européens layant ratifié ?
Cela pose la question de lavenir de la politique commerciale européenne et de son articulation avec la lutte contre le réchauffement climatique, dont la France se veut le leader mondial.
Agathe DAVID, chargée de mission
agathe.david@ethinvest.asso.fr

G de Vienne interpelle Air Liquide sur la part variable de la rémunération de son Président
réponse apportée dans le CR de l'AG du 3 mai 2017